Le plus grand insecte fossile
conservé dans l'ambre ?

Cet insecte de l'ambre avait une envergure de 11 cm !
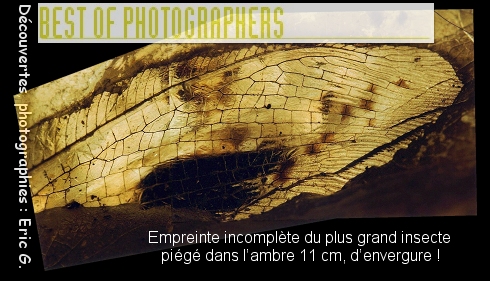
Retour
début du site
Le plus grand insecte fossile
conservé dans l'ambre ?

Cet insecte de l'ambre avait une envergure de 11 cm !
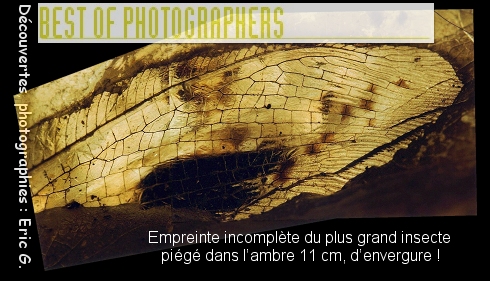
1998, les restes de cet insecte malgache (de l'Ordre des Planipennes)
constituent
l'une des traces les plus grandes jamais trouvées à ce jour dans
une résine fossile !
L'image (formée par le rapprochement de deux photographies papier, ci-dessu)
montre l'aile antérieure droite d'un insecte -énorme-,
vrillé dans la matrice d'une oléorésine fossilisée
en ambre. La portion de l'aile photographiée mesure 52 mm et permet d'estimer
l'envergure de l'insecte planipenne à 11 cm. Cette découverte
(1998) est hallucinante pour un prospecteur et constitue une référence
record qui démontre que le piège des résines peut opérer
sur de TRES grands insectes.
Cette référence (superbe!) invalide aussi le dogme (parisien,
publié encore récemment) qui affirme sans autre explication (confer
le premier
congrès mondial des inclusions de l'ambre) que seul peuvent être
piégées les espèces dont la taille est inférieure
au centimètre.
Tandis que l'un donne ses explications théoriques à la presse,
la présentation de cette référence invalide les propos
avalés avec délectation par les journalistes crédules.
Les oléorésines aériennes peuvent dans certains cas exceptionnels
rapporter des traces d'insectes 10 fois plus grands que ceux de la moyenne habituelle.
Cette seule référence permet de réviser le piège
des résines. Et, pour éviter les sciences théoriques il
est parfois utile d'examiner comment les végétaux piègent
les entomofaunes. Inventer un dogme assis les pieds au chaud dans les bureaux
de la capitale est une chose, observer la réalité de terrain puis
apporter les fossiles qui constituent les première pierres d'une bonne
démonstration (humour : les pierres d'ambre) en est une autre !
J'adresse ce message (comme une alerte) et mes critiques
renouvelées au journaliste qui se reconnaîtra et qui a préféré
le prestige du label à la réalité des faits. Pour
publier des articles vrais, faites d'avantage confiance aux fossiles qu'aux
personnes labellisées ! La science raconte souvent des
mensonges surtout pour l'ambre, et la vérité n'est pas une
propriété privée ! Une "spécialisation"
par un diplôme d'université pour tout CV n'a rigoureusement aucun
poids devant la réalité (factuelle) des références
du registre des fossiles. Messieurs les journalistes,
publiez ce que vous voyez et non ce que l'on vous dit ! Soyez critiques,
analysez les choses et observez.
Alors, on se pose souvent la question de savoir pourquoi ces inclusions
d'insectes de dimensions supérieures à 30, 40 mm sont si rares
dans l'ambre ?
"Seuls les petits insectes se retrouvent piégés dans la
résine fraîche, les plus grands ayant assez de force pour s'en
extirper. …/…"
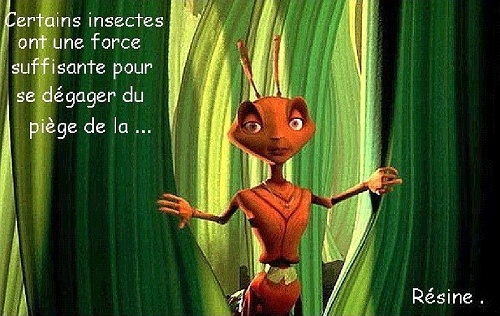
Ce renseignement "précieux" de Monsieur Didier Néraudeau
paléontologue à Université de Rennes, extrait de l'article:
"D'ambre et d'insectes", (La recherche N°370, décembre
2003) est encore basée sur le constat que les inclusions d'insectes de
l'ambre sont souvent "petites" à "minuscules"…
(Rires).
Dans les temps anciens, sans doute quelques insectes pouvaient-ils se désengluer
(volontairement). Cependant tous les spécimens n'avaient pas cette capacité,
et, le cas de cet insecte de l'Ordre des Planipennes résulte d'un incident
majeur lors de la bascule de l'arbre producteur de résine au cours d'une
forte tempête.
La juxtaposition de deux photographies prises dans la courbure de la coulée
de résine renseigne sur la position de l'aile durant la formation de
l'écoulement (démonstration par l'analyse taphonomique de la
position de l'animal).
La dimension imaginée limite des insectes qui resteraient piégés
dans les oléorésines pourrait (hypothétiquement) se situer
aux environ du centimètre… Ce facteur dimensionnel (vérifié
par quelques expériences de terrain) s'applique surtout aux insectes
ailés dont la vulnérabilité réside principalement
dans l'immobilisation des ailes. Dans certains cas, en examinant les pattes
abandonnées par l'insecte fossile on peut établir comment celui-ci
a réussi à se dégager par autotomie, (amputation volontaire
reconnue, par exemple, chez les moustiques Tipulidae).
Cependant un principe unique (la taille corrélée
à une force), et, énoncé aussi simplement dans une publication
conséquente et sans autre hypothèse…
est sans doute inexact.
En effet des inclusions de grandes tailles existent dans les résines
fossiles.
Les animaux, insectes, mille-pattes, arachnides, qui sont entrés dans
la résine ont pu être attirés par sa "luminosité"
ou même son odeur. Ils ont pu être aussi écrasés accidentellement
sous une chute ou projetés contre la résine fraîche par
quelque bourrasque… L'interprétation de ces scènes par le
déchiffrage des traces internes ou externes est riche d'enseignements !
L'ambre nous offre le scénario des derniers instants de vie des organismes
piégés...
La dimension limite des insectes qui restent piégés dans les oléorésines
fossiles doit être révisé au regard d'une autre hypothèse
toute aussi essentielle. D'ailleurs, le facteur dimensionnel semble s'appliquer
différemment selon les types des résines, et, aussi et surtout,
selon les ordres d'insectes !
Il est intéressant de noter que les blattes (indépendamment
de la constitution des paléoentomofaunes) forment le contingent le plus
important des grands insectes que l'on peut apercevoir immobilisés
dans différents gîtes à ambres. Bien que rapides, puissants
et possédant une morphologie avantageuse pour fouiller parmi des substrats
pesants, ces animaux apparaissent fréquemment stoppés sans même
aucun mouvement d'agonie dans la résine piège…
Les expérimentations d'engluement réalisées, il est vrai,
avec des résines contemporaines (et donc inévitablement différentes
de celles qui sont à l'origine des ambres), confirment qu'il faut rester
extrêmement prudent concernant ce sujet.
Bien que collantes et toxiques, les résines des conifères semblent
parfois inopérantes pour piéger des insectes.
Des petites ou grandes libellules sécrètent, par exemple, des
huiles spécifiques qui les rendent imperméables et leur permettent
d'éviter la noyade lorsqu'elles pondent à la surface des plans
d'eau. D'autres insectes (des larves de diptères Wilhelmina nepenthicola)
vivent impunément dans les sécrétions digestives des plantes
carnivores... Des larves de mouches (Psilopa petrolei) peuvent demeurer
dans des mares de pétrole, et, plus extraordinaire encore, les diptères
Cecidomyia pini peuvent subsister dans les oléorésines
pourtant poisseuses et collantes des conifères !!!…
Concernant les inclusions fossiles de l'ambre, il est possible parfois de trouver
de gros insectes vigoureux et puissants munis de "petites ailes"…
Et, de temps à autre, on peut démontrer que l'animal peu vulnérable
a été piégé vivant !

Etouffant dans
la résine, cette superbe
guêpe balte (Hymenoptera Chalcidcidoidea : Torymidae)
emploie son dard pour piquer et trouver un moyen de fuir. Ce détail
prouve que l'insecte était vivant en entrant dans la résine.
Cette guêpe, pourtant robuste, n'a pu résister à la
résine collante, et aussi et sans doute, au poison foudroyant ?…
Les entomologistes qui préparent les insectes fragiles dans des cadres
d'expositions savent qu'il existe pour les tuer rapidement des poisons volatilisables
spécifiques.
Chez les insectes, l'air est amené aux cellules par un réseau
de tubes, (ou tubules), de plus en plus fins. Cinq pour-cent environs des insectes
de l'ambre meurent si vite qu'ils conservent une position figée parfaite,
parfois sans étouffement apparent.
La mort si rapide de quelques spécimens robustes (comme celui en
photo !) suggère que la résine devait agir par quelques "neuro-bloquants"
spécifiques…
Les hypothèses pour expliquer le piège de l'ambre sont nombreuses
et il est dommage de réduire continuellement la réalité
des phénomènes. Quoi qu'il en soit, le critère de la
force n'est alors pas le seul principe à considérer…

- ©
2002 Ambre.Jaune -
Contact E-mail Auteur : eric.ambre.jaune@hotmail.fr
Contact E-mail Equipe technique : ambre.jaune@free.fr