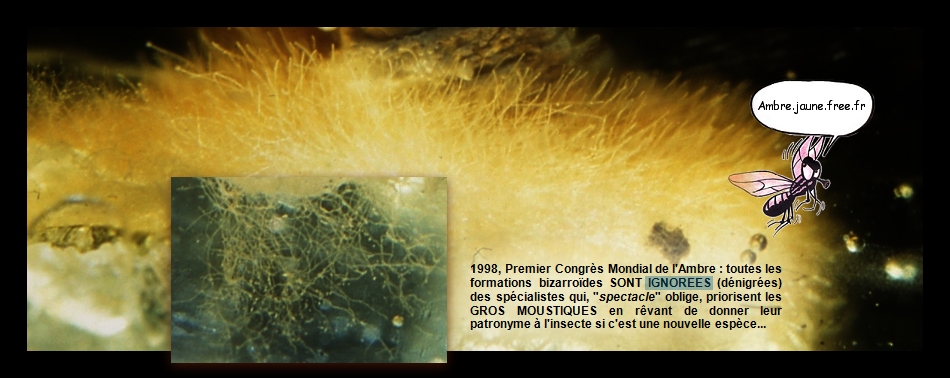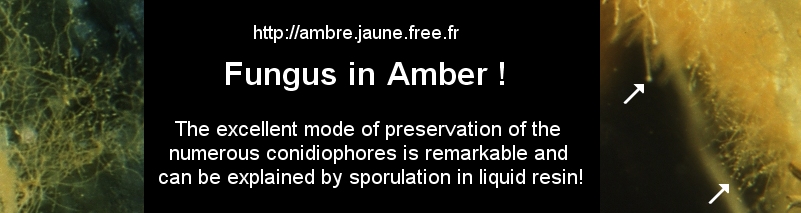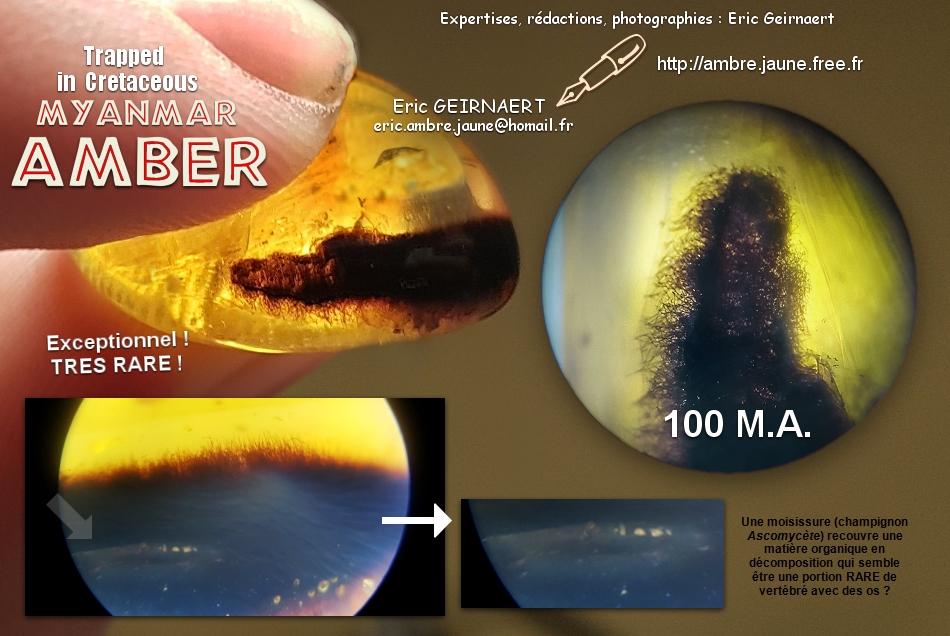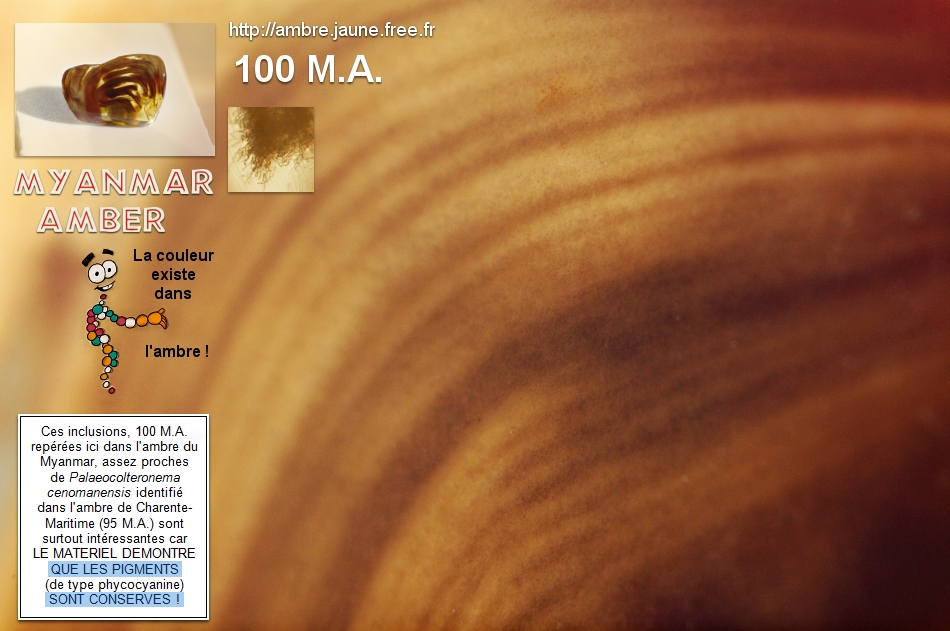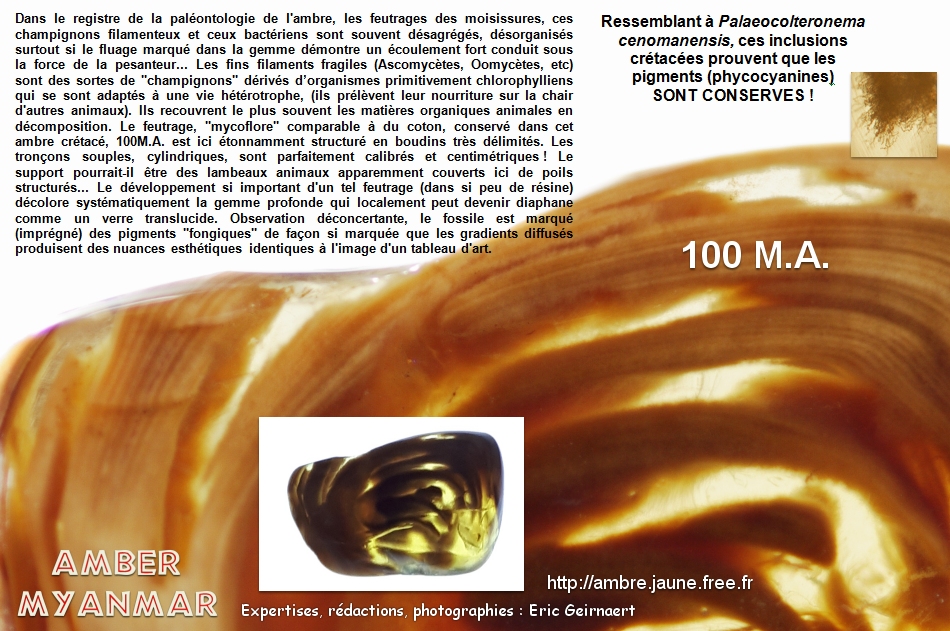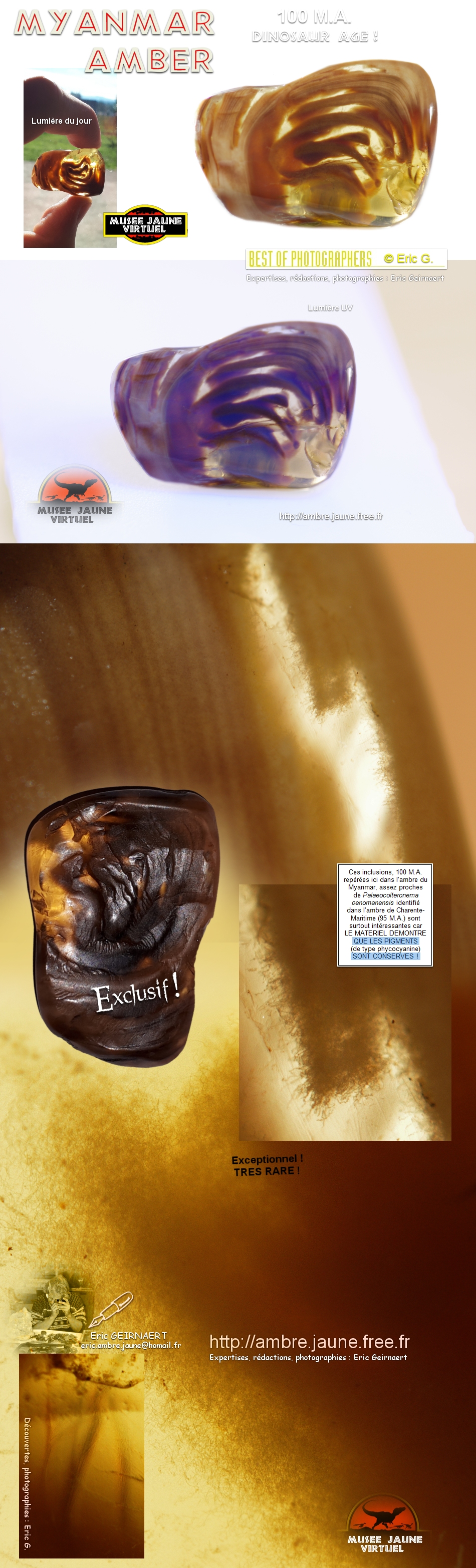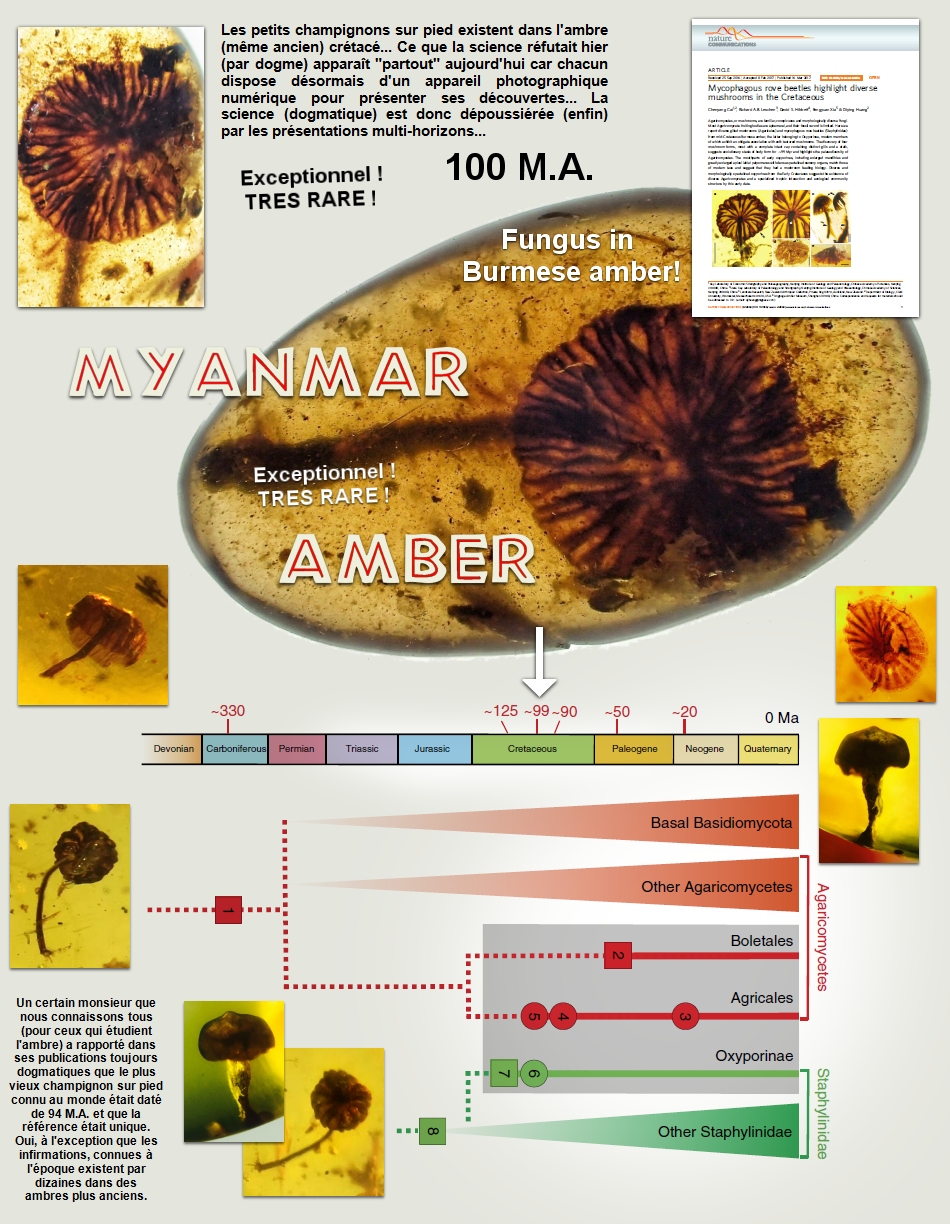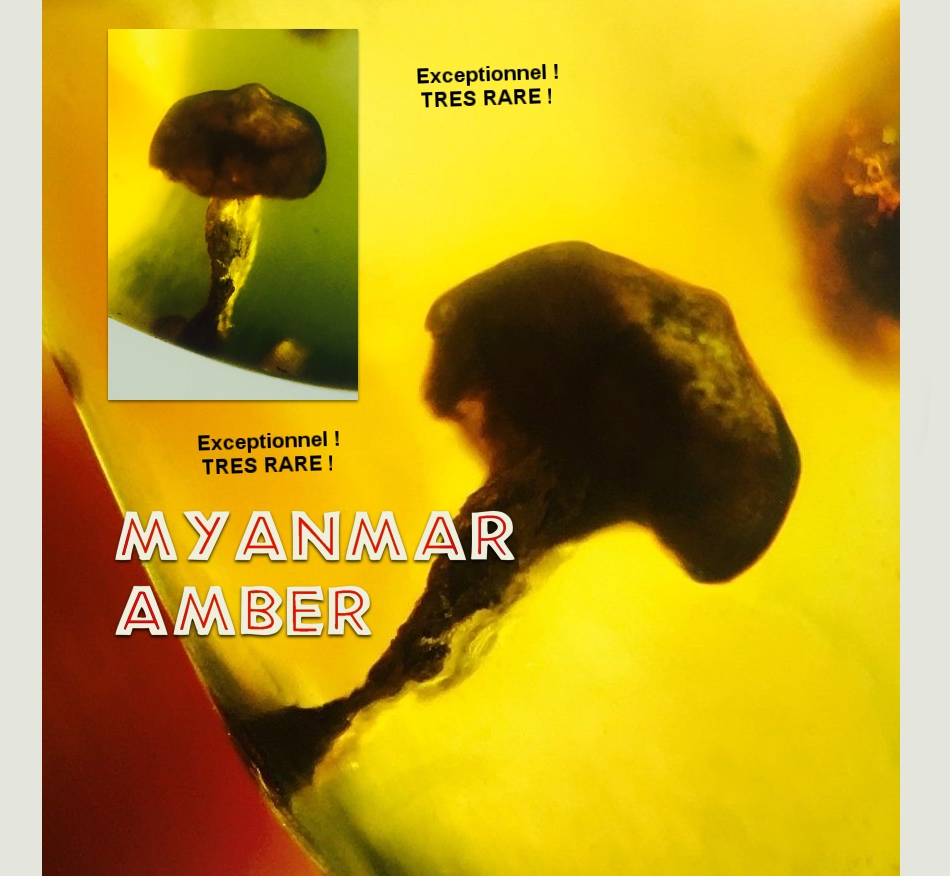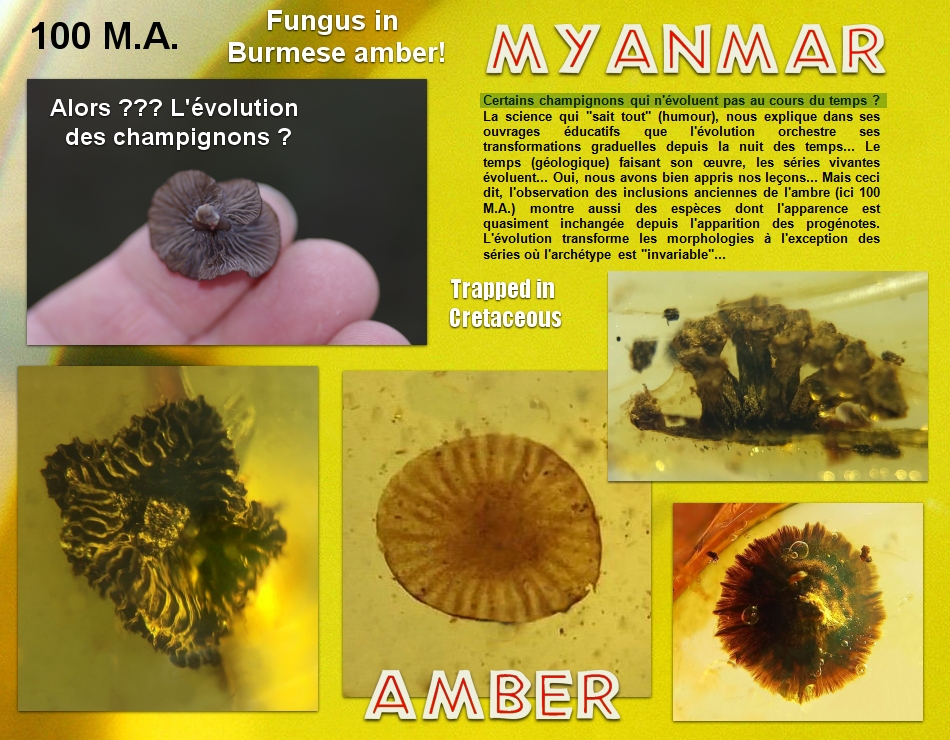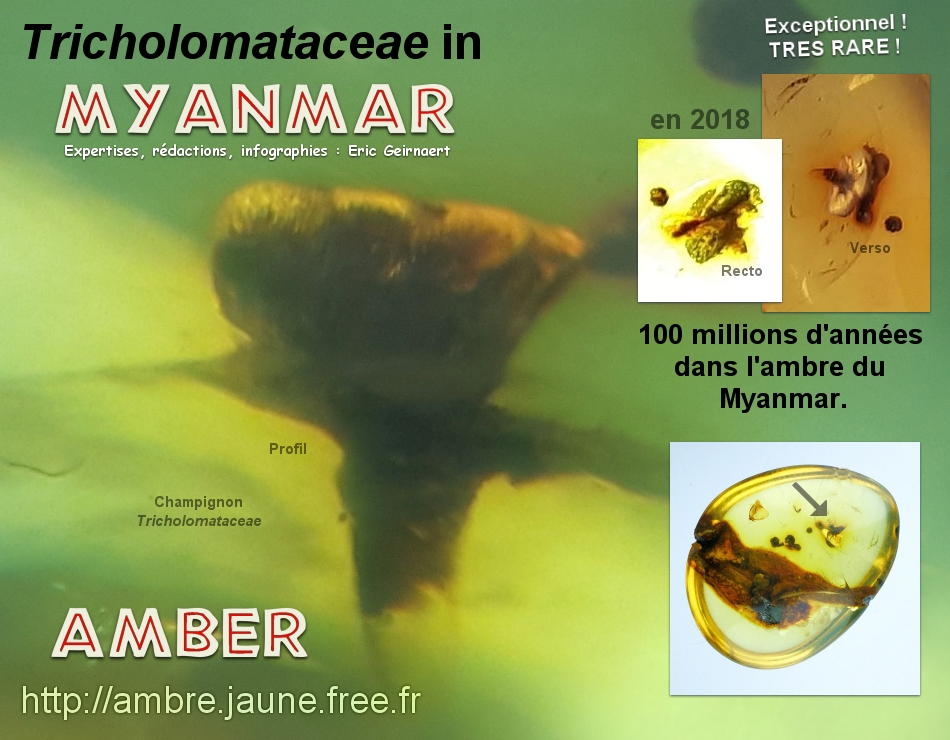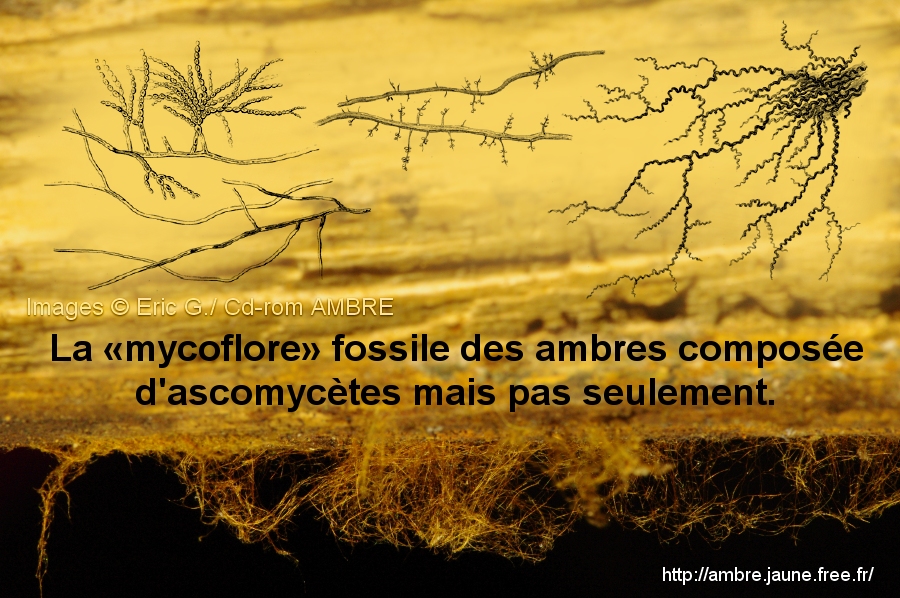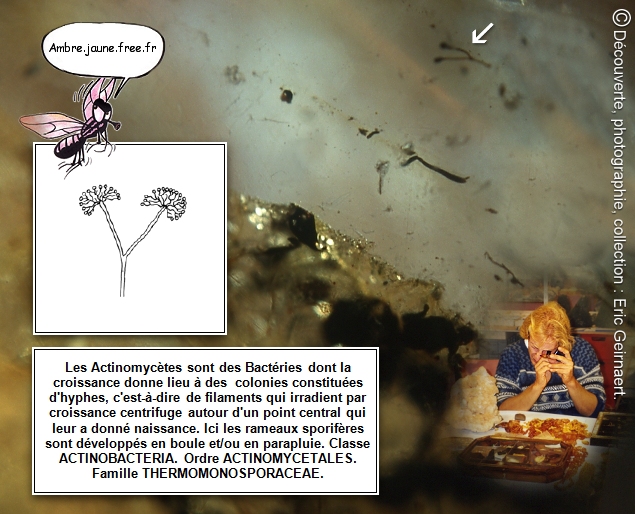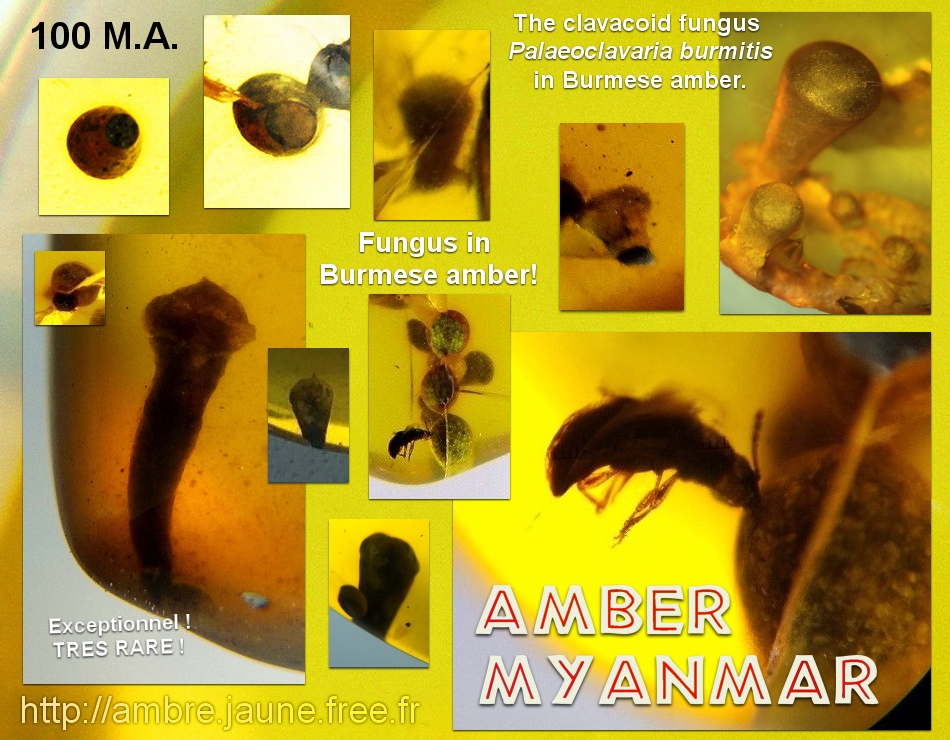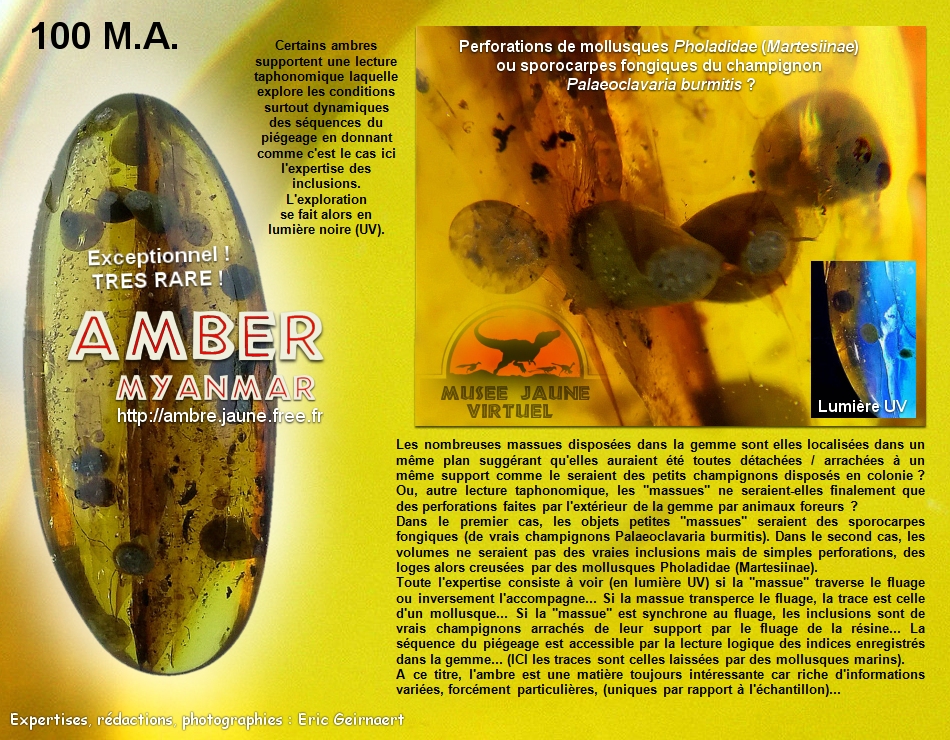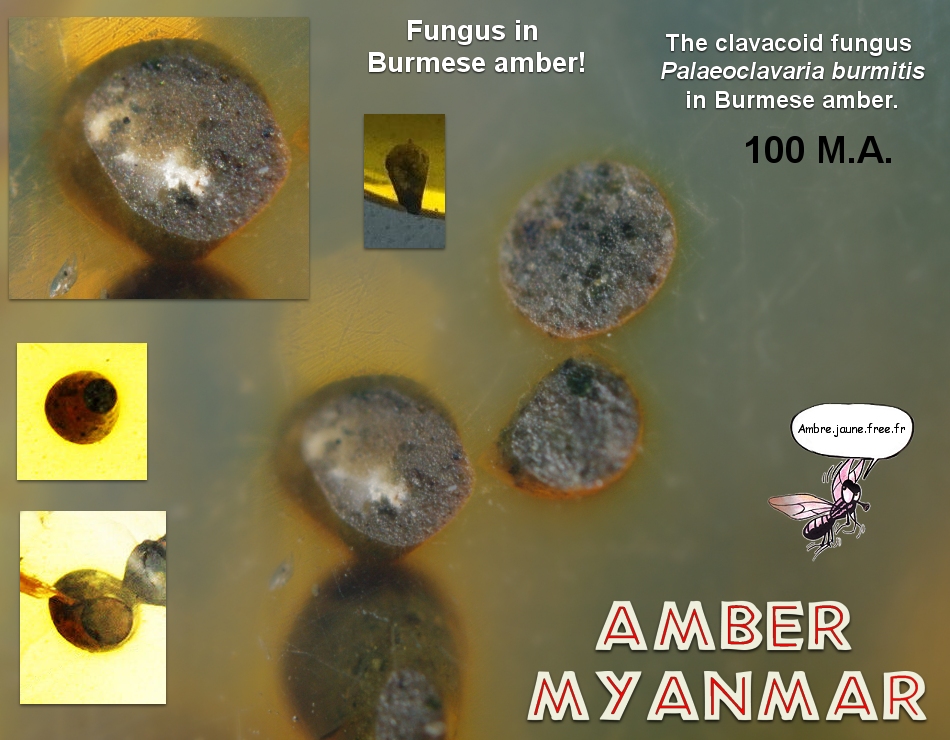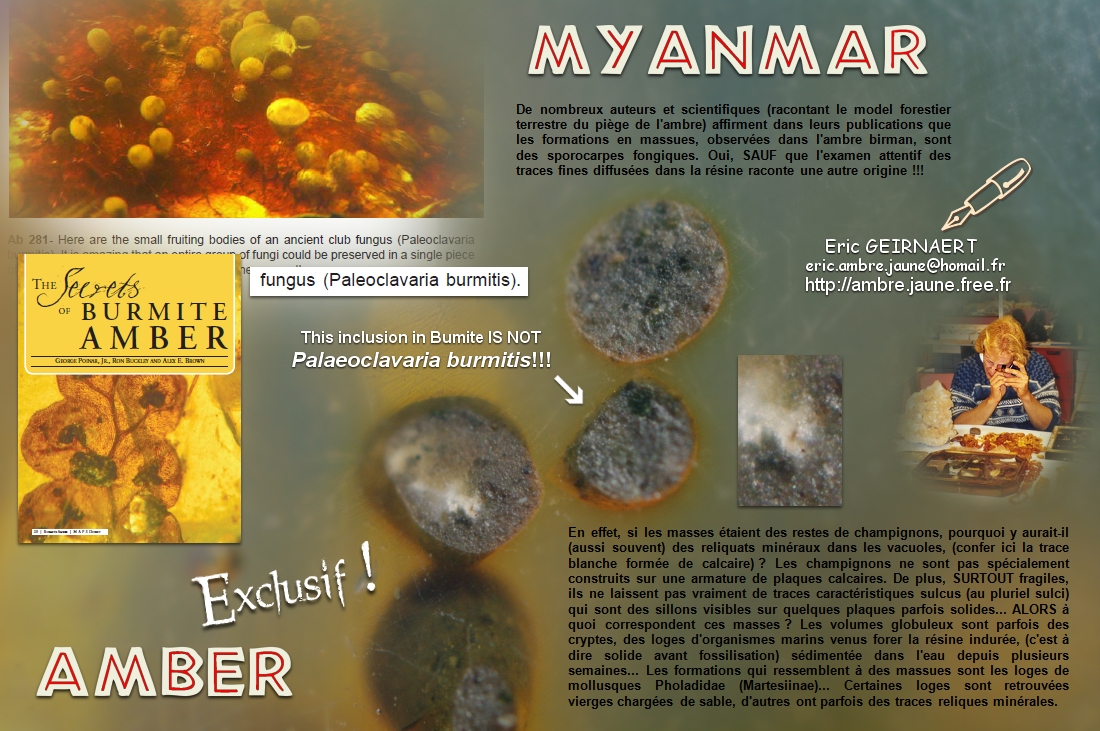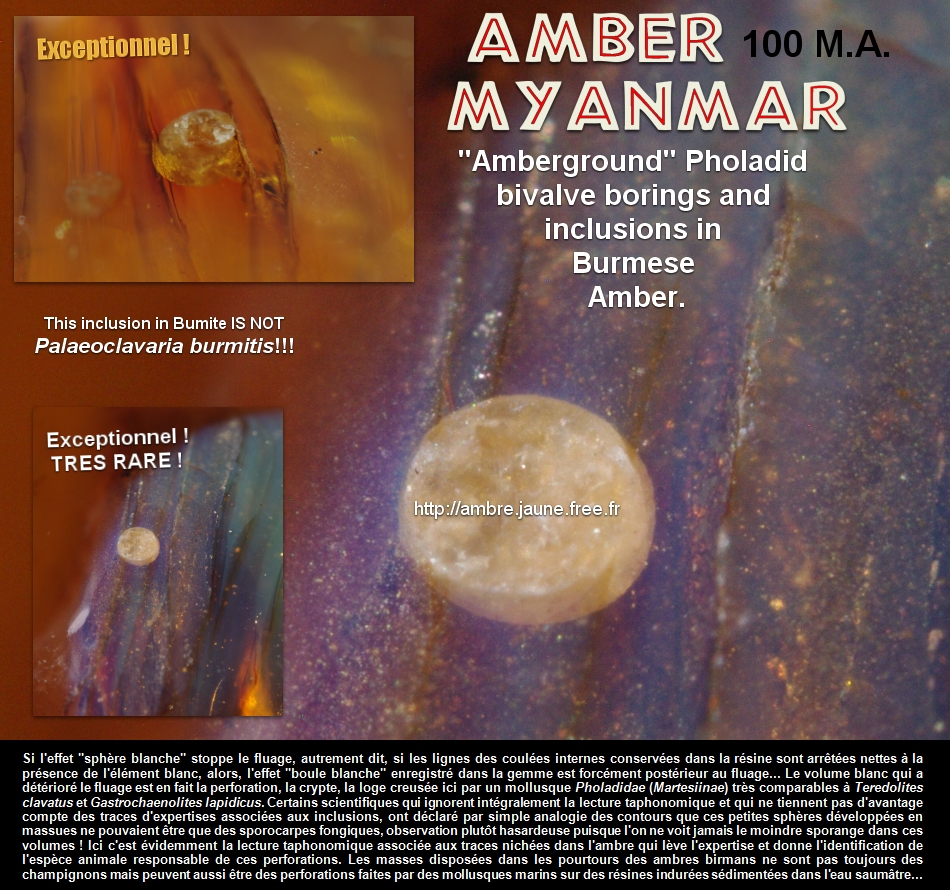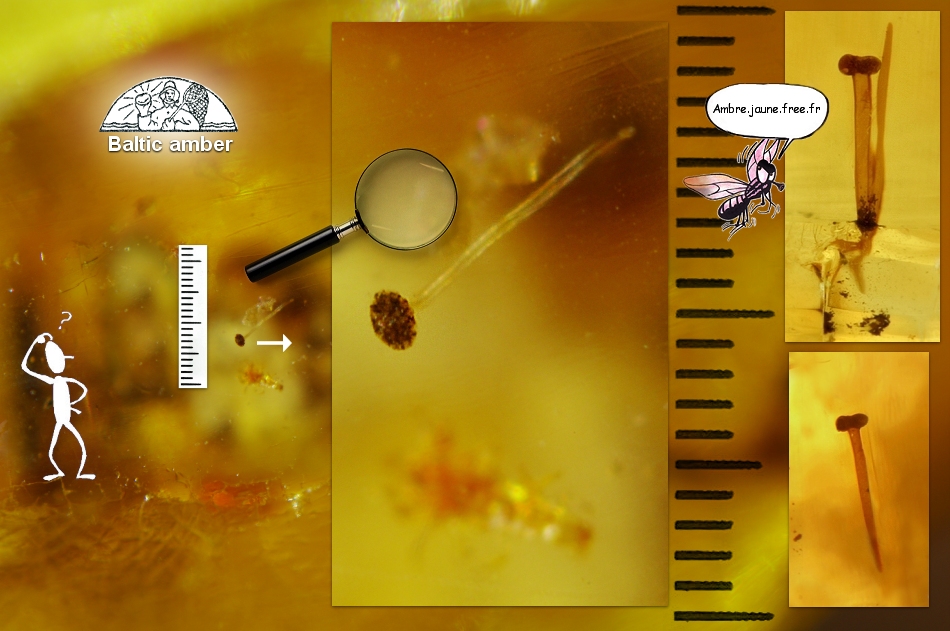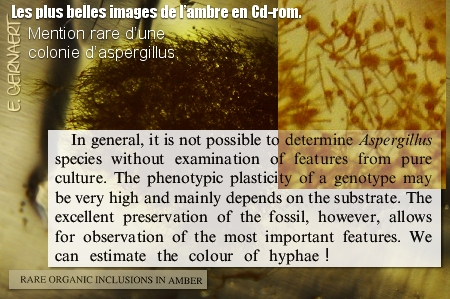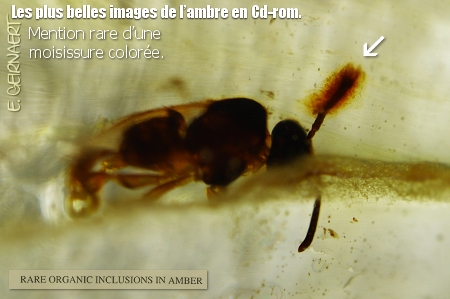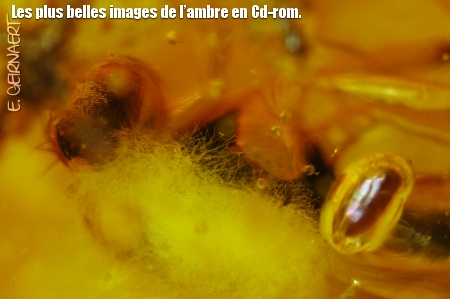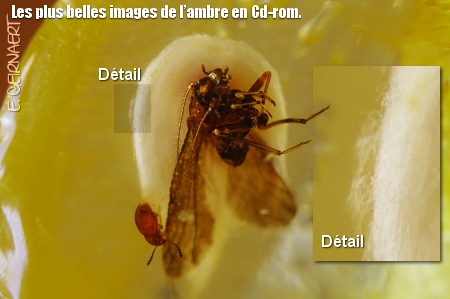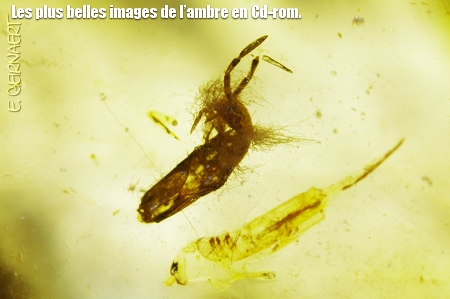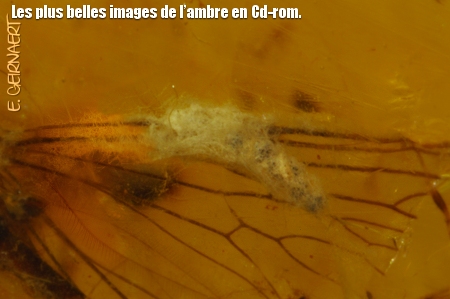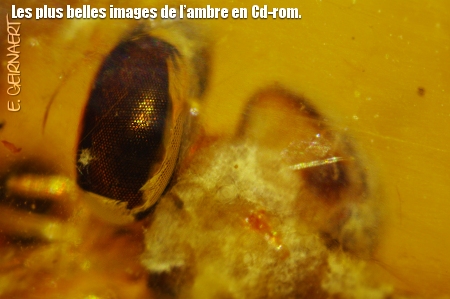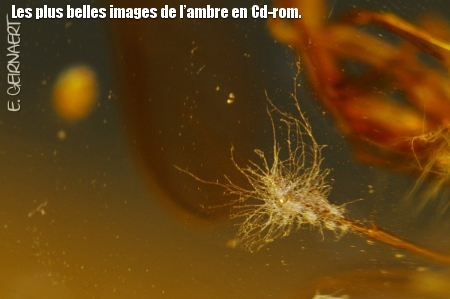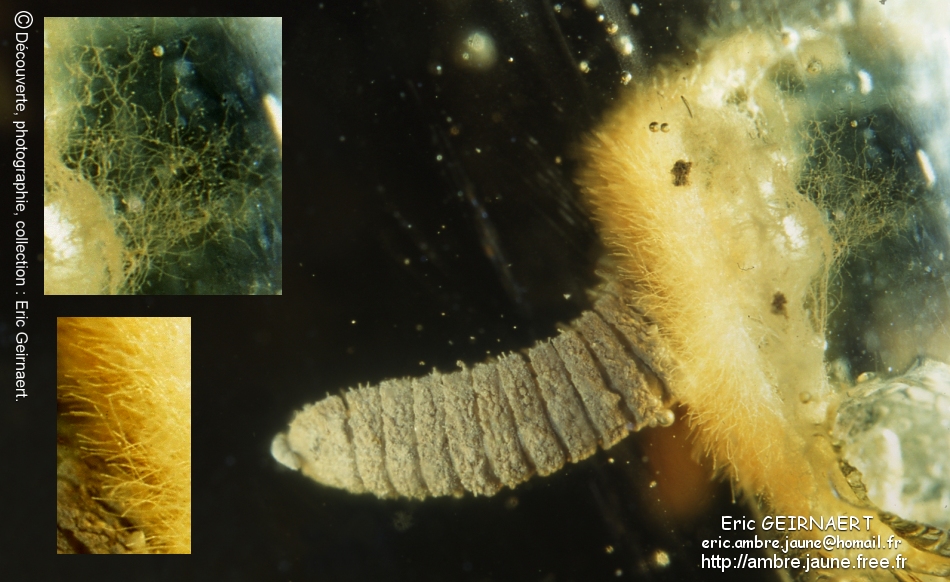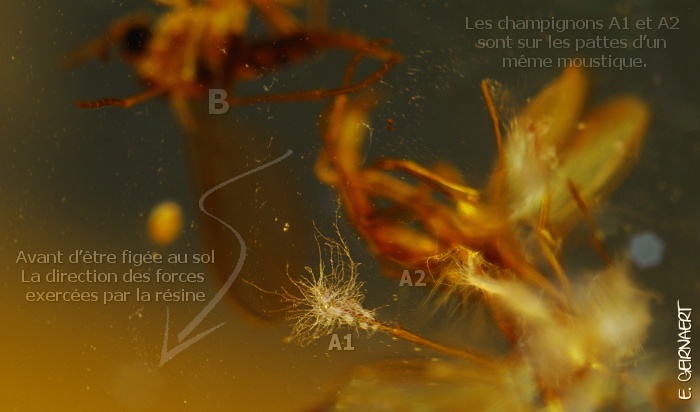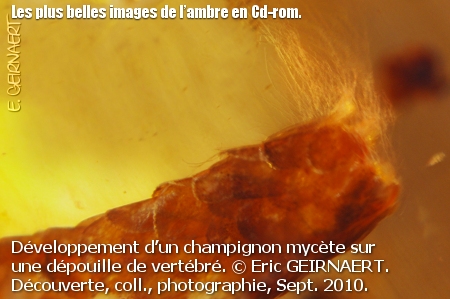Retour
début du site
Il n'y a pas si longtemps,
le champignon et les
moisissures de l'ambre N'EXISTAIENT PAS !
Comme
quoi il ne faut jamais désespérer ! Les
détracteurs (toujours les mêmes, qui connaissent l'ambre,
car autoproclamés "spécialistes") affirmaient
avec force et virulence que la résine à l'origine de l'ambre,
hydrophobe, constituait un milieu stérile (mortel) pour les champignons
et que ces derniers surtout fragiles ne pouvaient avoir colonisé
le milieu piège... Et, de fait, L'ENSEMBLE des observations rapportées
en images (Eric G. 1998) par certains et même d'autres n'étaient
que des artéfacts (des souillures géologiques) survenues
lors de la fossilisation...
Pour dire la chose plus simplement, en 1998, en 2000 puis en 2002, les
champignons N'EXISTENT PAS et ne peuvent pas avoir existé dans
l'ambre... Ceci-rappelé (rires), COMME je suis heureux de
voir aujourd'hui (2015), donc 17 ans plus tard, que les détracteurs
écrivent après avoir réexaminé
leur collection: "Among 798 pieces of
amber from first collection only 3 inclusions contained insect associated
fungi".
Preuve est donc faite que la chose existe (depuis toujours) !!!
Mais, la science de l'ambre n'a de validité que si (et seulement
si) c'est "DIEU le Père" (LE SCIENTIFIQUE qui a l'autorité
divine) qui réalise l'observation, lui et lui seul, sur ses propres
matières...
|
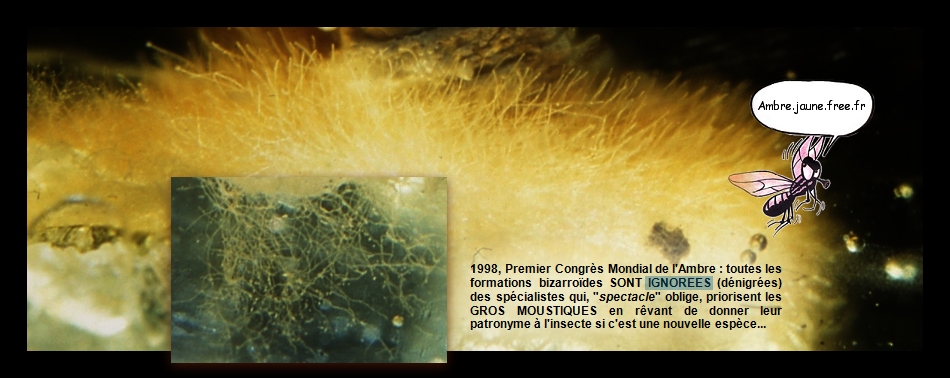
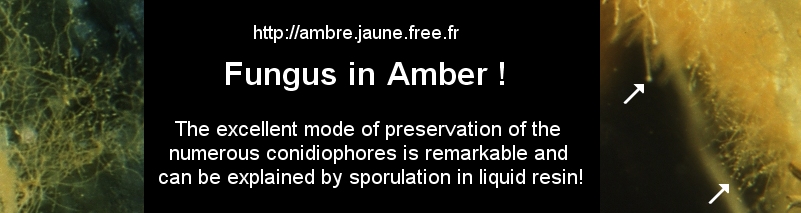
Les moisissures (surtout
présentes sur les matières organiques
en décomposition) sont rares dans l'ambre crétacé birman.
Et, voici des pièces (100 M.A.) assez exceptionnelles :
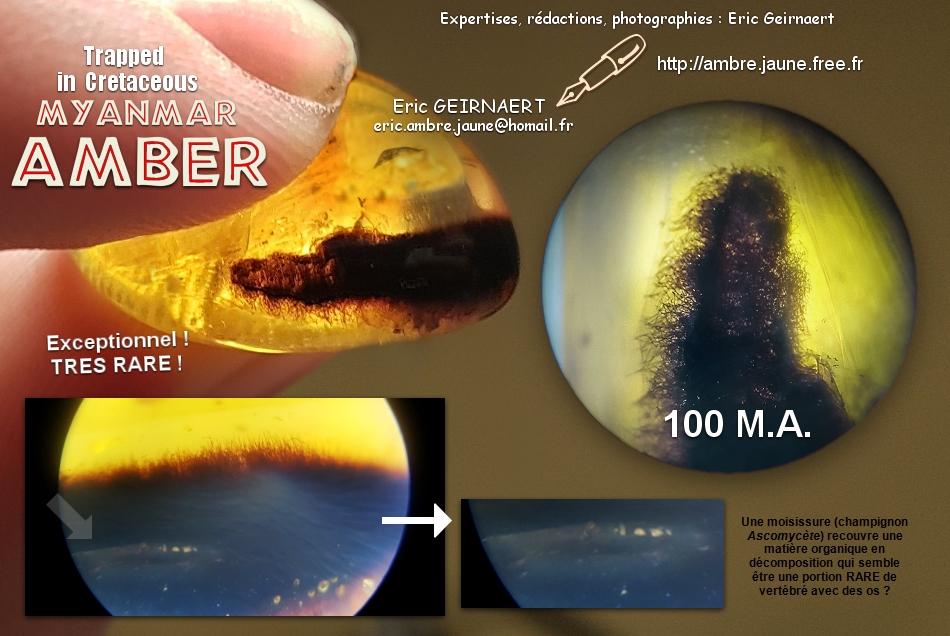
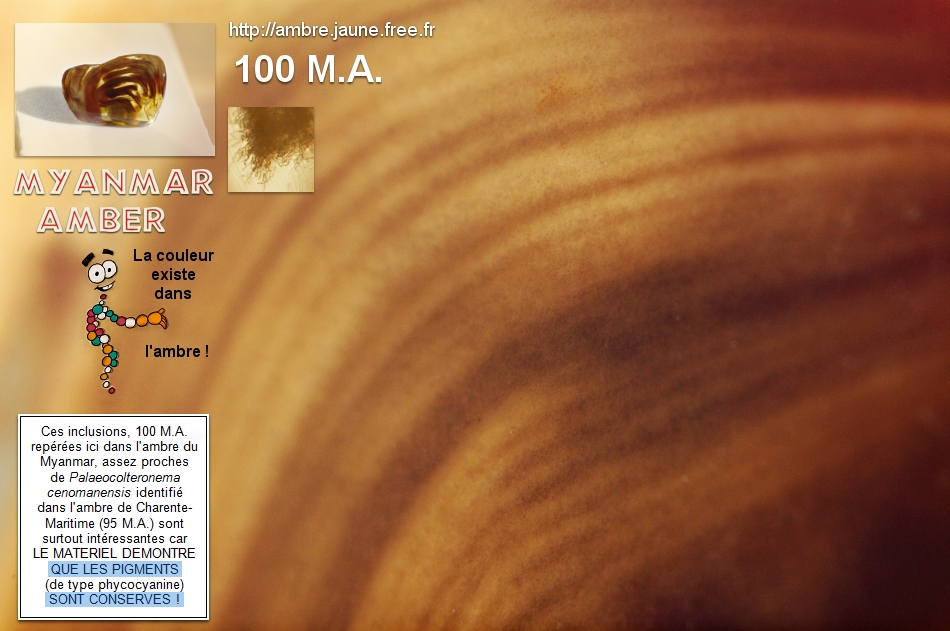
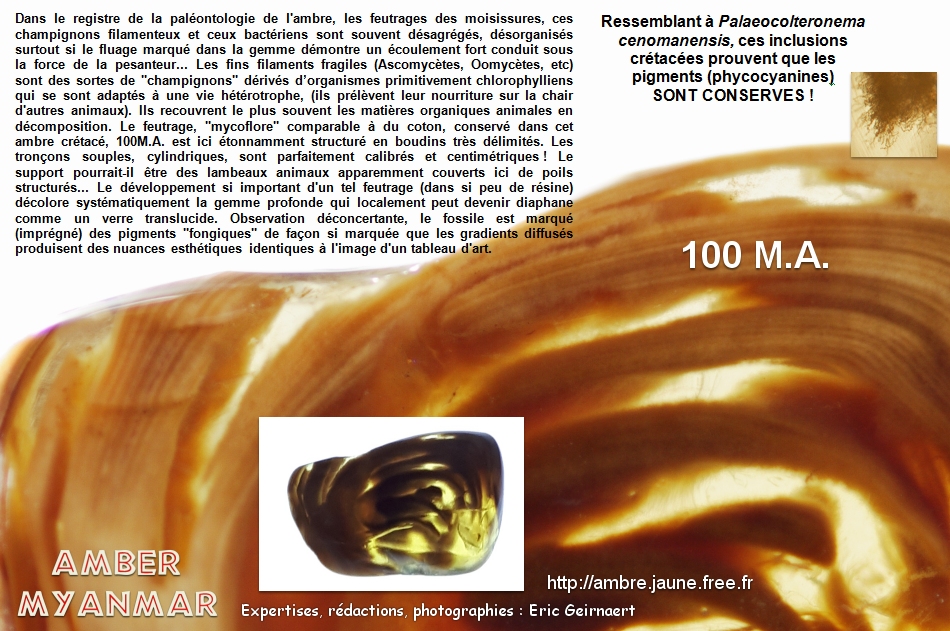
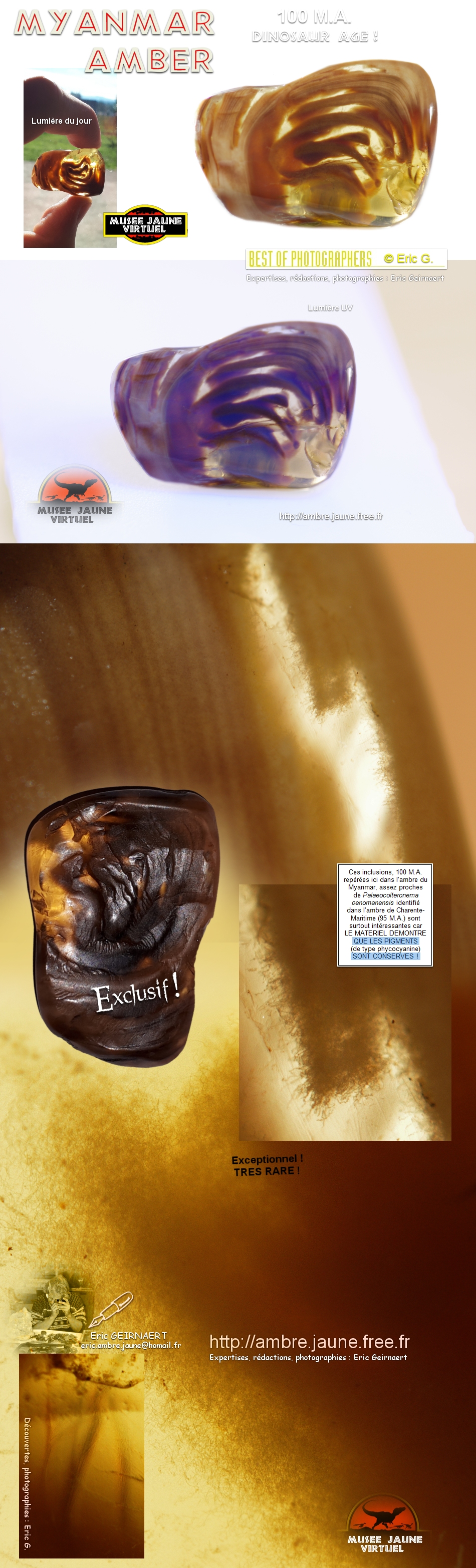


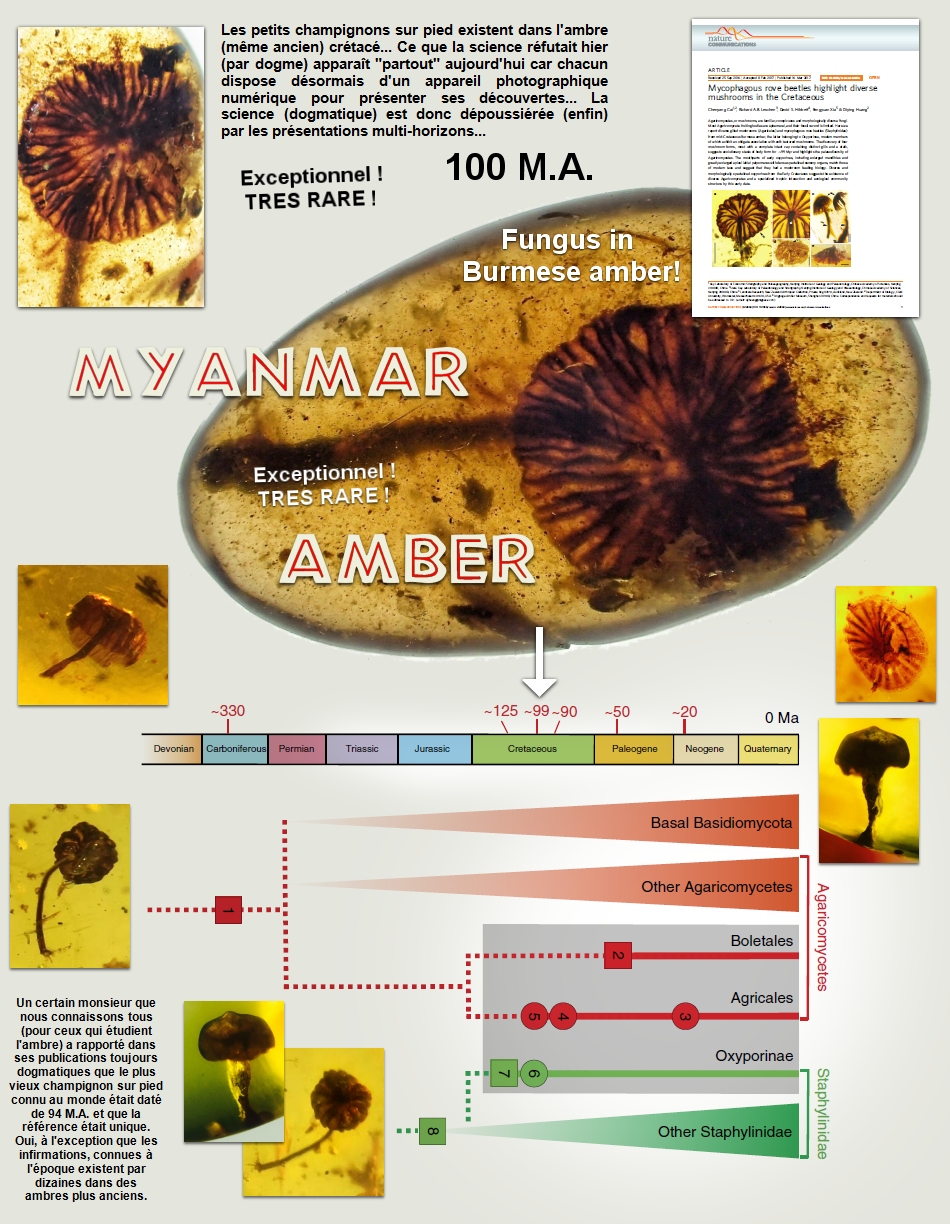
Autre référence rare datée à 100 M.A. :
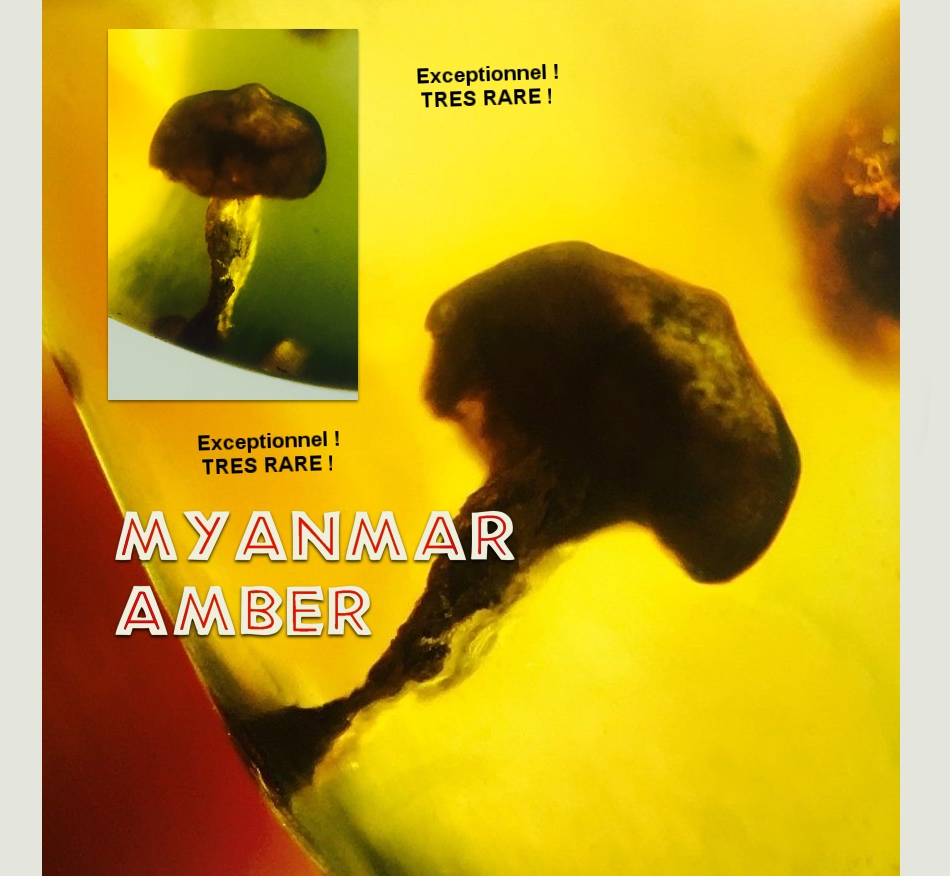

A lire : FOSSIL MUSHROOMS FROM MIOCENE AND CRETACEOUS
AMBERS- American
Journal of Botany 84/8, p.981 à 991-1997.
En 1997 le plus vieux champignon connu à 94 M.A. En, 2017 observons
quelques références RARES à 100 M.A. et autres inclusions
étranges...

Le
vocabulaire scientifique est si foisonnant en mycologie que le
dossier technique de l'évolution des champignons est surtout obscur...
Et, pour compliquer d'avantage le sujet, l'évolution des séries
(vérifiée au niveau moléculaire avec des modifications
génotypiques) peut opérer sous le seuil radar des caractères
plésiomorphes... L'évolution chimique, moléculaire
est en marche mais ne change pas forcément le caractère
biologique considéré dans l'analyse cladistique... Et le
chercheur de raconter tout cela dans un jargon inextricable...
|
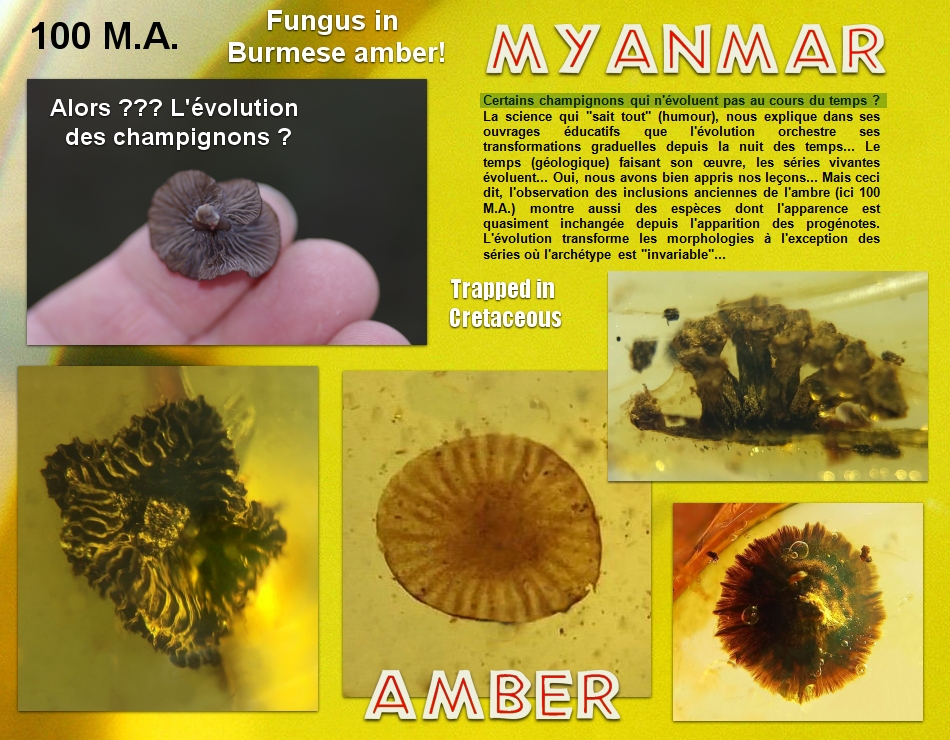
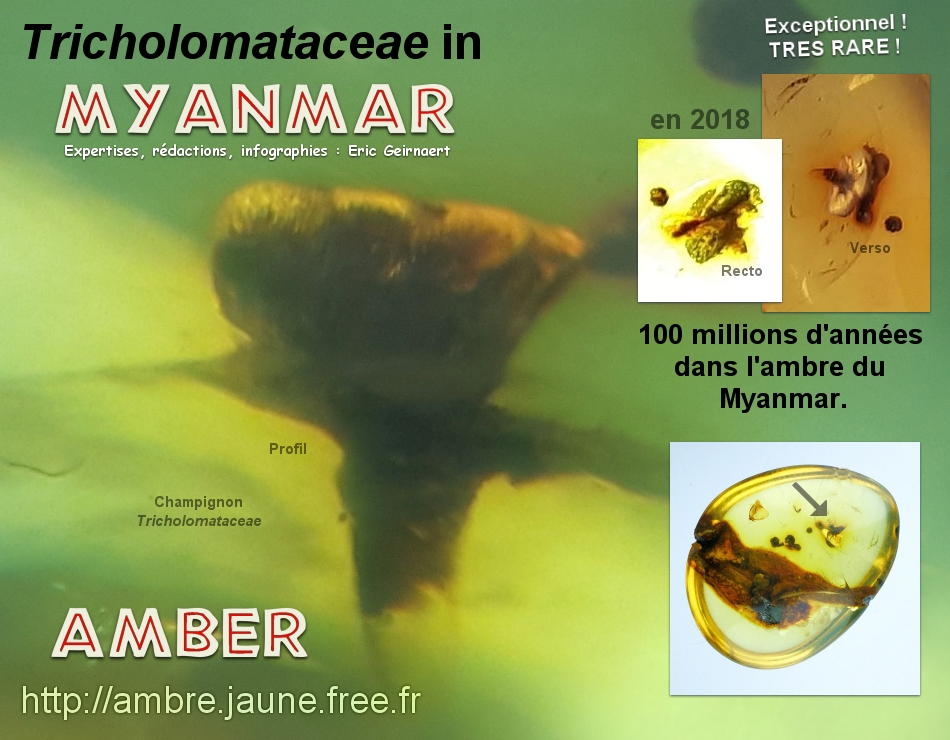
Et, le champignon ci-dessus Tricholomataceae (100 M.A.) est situé
dans cet
ambre magnifique.
Pour
situer la place FONDAMENTALE ce dossier dans la science de l'ambre permettez
cette introduction "sociologique" qui "explique"
la paléontologie...
Pour laisser la marque (son nom)
dans l'histoire de sa discipline, pour exister sous les feux de la rampe
devant les concurrents, le paléontologue (sans même s'en
rendre compte, guidé par son mentor construit du même bois)
a raconté l'histoire passée du monde en mettant les pièces
du puzzle à l'envers. De longue date, pour ne par dire depuis
toujours, le seul travail reconnu du paléontologue (maintenant
rémunéré) consistait à cataloguer le plus
grand nombre d'espèces possibles pour appliquer des noms aux
séries différenciées par la biométrie de
quelques structures... C'est l'âge d'or des inventaires qui
tournent à la frénésie débridée avec
l'ambre où les animalcules apparaissent par milliers...
A cette époque, le dogme affirme que l'homme est au somment du
vivant, et ceci étant, on va compter ses rivaux. On va dénombrer
les espèces actuelles et fossiles... Selon la taille et la forme
des appendices considérés, l'omniscient raconte alors
les espèces actuelles et passées. Jusqu'à l'écueil
de donner 53 noms scientifiques différents à une seule
et même éponge ! (Rires !) Jusqu'à l'ineptie
de donner des noms différents à des animaux qui changeaient
seulement d'allure selon leur âge, (c'est le cas des dinosaures).
Et, que dire de ces entités biologiques qui d'un stade larvaire
à 6 pattes (donc "insecte"?) deviennent autre chose
puisque parés d'un nombre variable d'appendices après
une mue intermédiaire ? Bigre, la nature est indomptable
et ne veut pas se soumettre à la classification des espèces
inventée par la science... Le concept d'espèce
n'étant théorisé pour les fossiles que sur les
seules formes adultes, le jeu de description des archives à trouvé
ses limites. En admettant que 10 millions d'espèces vivent
actuellement sur Terre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un
milliard d'espèces différentes dans le grand livre paléontologique
du monde (où les formes adultes côtoient évidemment
les formes juvéniles). Dans ce grand bal halluciné des
inventaires, les paléontologues anglais de l'ambre (ayant épuisés
tous les noms patronymiques de leurs clans) vendent encore en 2010 au
public (sans
humour, pour 10.000 €) le nom des espèces fossiles.
En affirmant par le dogme que l'homme est au sommet de toute chose,
dans l'espace temps terrestre, le paléontologue ouvre le grand
livre de la Vie et invente la notion d'espèce comme une "bulle"
incompressible déjà placée dans un décor
linéaire ou plan. (Bien évidemment
le mot linéaire est ici un raccourci de rédaction car
tout le monde sait aujourd'hui que l'évolution se développe
comme un buisson rayonnant en 3D. Cela n'est plus du tout linéaire !
) Mais, pour simplifier, disons qu'au plus bas il y a les
minéraux, puis il a les végétaux, ensuite, viennent
les animaux et enfin l'homme arrive au sommet des chaines de prédations.
Dans cette conception, dans cette dichotomie
(fausse) du monde, le chercheur donne une audience aux théories
les plus médiatiques (comme celle de la disparition des dinosaures
par la météorite), où à celles qui valorisent
la suprématie de quelques concepts (comme le plus méchant
mange le plus fragile). Dans cette lecture médiatique des choses,
le paléontologue (qui commente la vérité dérisoire)
ne s'intéresse qu'aux fossiles le plus visuels. Pour dire les
choses simplement, on raconte la Vie passée au nombre de bulles
qui cohabitent par époques, les unes à côté
des autres. Les bulles ne peuvent pas se mélanger. Et, si elles
éclatent, si elles disparaissent, on appelle cela une extinction.
Pour expliquer les extinctions (le défaut de bulles par époque),
les paléontologues inventent des théories rapportées
(parfois saugrenues car déjà révisées d'une
rustine pour supporter les contre exemples). Dans cette
narration égo-centrée (sur l'homme) et lucrative,
où les fossiles prestigieux se vendent très cher, les
fossiles TRES visuels sont priorisés. Pourtant l'essentiel de
l'histoire se joue dans l'invisible et le minuscule plutôt informe.
(comme ces filaments ci-dessus dénigrés des chercheurs).
Les
grandes étapes des bouleversements du vivant se sont jouées
sur une partition qui n'a laissé pour ainsi dire aucun fossile.
En hiérarchisant les acteurs de l'histoire du monde : [minéraux,
végétaux, animaux, homme] le narrateur s'est isolé
des rouages fins du monde. Les bouleversements majeurs du monde ont
été opérés par des acteurs imperceptibles
(et plutôt absents du registre des fossiles). L'émergence
de l'atmosphère s'est mise en place par l'activité d'organismes
minuscules dans la soupe marine primitive... Des bactéries, des
algues, des champignons, des moisissures sont devenus les acteurs 'imperceptibles'
mais moteurs des grands équilibres respiratoires qui ont orchestré
les étapes cruciales du vivant... Les végétaux
fortunés sur une atmosphère (particulière) ont
prospéré et se sont accumulés en dépôts
tellement encombrants qu'il faut attendre l'invention des moisissures
blanches au carbonifère pour nettoyer le grand désordre
des dépôts végétaux carbonifères.
Puis, lorsque les plantes à fleurs, pionnières des lacs,
(dans les eaux évidemment stagnantes) ont déposés
leurs matières alors décomposées par des organismes
saprophytes, les équilibres en oxygène ont encore été
modifiés ruinant les animaux incapables de moduler leur respiration.
Tous les acteurs biotiques de la planète sont sous contrôle
(direct et indirect) des champignons et assimilés qui orientent
et conditionnent les végétaux (autotrophes) et guident
alors les équilibres gazeux de la planète.
Pour ne donner qu'un exemple, prenons la fourmi camponote. Certains
champignons parasites peuvent prendre le "contrôle"
ce certaines espèces animales pour les guider vers des situations
originales et favorables à leur dissémination en dispersant
par exemple leurs spores à partir des hauteurs d'un couvert végétal.
Des fourmis Camponotes qui sont parasitées par des Ophiocordyceps
meurent par des protéines qui détruisent les muscles des
mandibules de l'insecte (qui restent fermées) et maintiennent
ainsi l'insecte cramponné au couvert végétal améliorant
la reproduction du champignon.
L'homme n'est surtout pas au sommet de la pyramide du vivant. Il est
d'avantage sous l'influence de tous les maillons sous-jacents qui forment
la chaîne trophique. Le ROI, le grand chef qui orchestre tout
depuis la base est sans doute le "champignon" ubiquiste qui
règne sans partage depuis toujours. Ignorés de la science
spectacle paléontologique qui raconte les seuls fossiles médiatiques
(et donc oublié de l'argumentaire explicatif), les champignons,
les bactéries, les moisissures, les algues sont "jetés
aux oubliettes alors que ce registre constitue le terreau d'articulation
du vivant. Informes, fragiles, imperceptibles, minuscules et éphémères,
ces organismes aux traces reliques inappréciables sont dénigrés
des paléontologues (au moins de l'ambre) au seul prétexte
qu'ils ne sont pas médiatiques. Pourtant les plus grands Arthropleura
(ces scolopendres gigantesques de plus de 3m de long) que l'on retrouve
uniquement dans le charbon fossilifère d'Autun ont été
conditionnés par la respiration passive rendue possible par une
atmosphère riche en oxygène. Pour prendre un exemple opposé,
la disparition mondiale des batraciens contemporains contaminés
par le petit champignon chitride pathogène démontre que
le règne fongique peut décimer un groupe animal sans laisser
de trace fossile du coupable. Un autre phénomène étrange,
certaines forêt (jusque là saines et normalement productrices
d'ambre) peuvent devenir malades (on a parfois évoqué
le terme de succinose) et ne rapporter AUCUN insecte inclus dans l'ambre
(rendant l'énigme inextricable) alors que le coupable peut sans
doute être identifié dans l'activité d'un acteur
du règne fongique qui modifie les biotopes des eaux stagnantes.
Les champignons (et associés) ont démontrés qu'ils
pouvaient coloniser les gemmes résineuses et même l'ambre
supposés être des milieux plutôt abiotiques. Les
grands animaux jusqu'aux plus petits et également les végétaux
sont contrôlés pour ne pas dire "manipulés"
par les champignons. Tout cela pour dire que ce registre est le ciment
d'évolution des tous les autres.
|
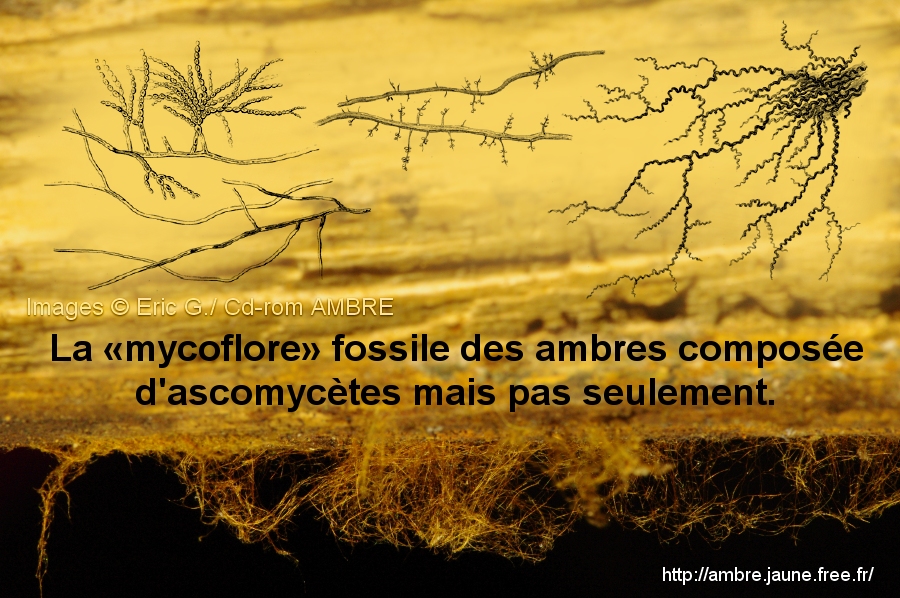
|
Formant
un feutrage parfois dense, les champignons, moisissures et
"assimilés" (feutrages bactériens) peuvent
apparaître à profusion sur le bois mort et donc tomber au
piège aérien des résines. Mais, la grande famille
des moisissures et assimilées a aussi ses acteurs qui peuvent coloniser
les matières sous l'eau. Sans tomber dans la systématique
pure et dure, les Oomycetes par exemple, qui sont eucaryotes filamenteux
non photosynthétiques, ressemblent au groupe proche des champignons
et sont surtout des espèces aquatiques. De fait exclusivement aérien
ou souterrain et agissant parfois aussi en milieu inondé, le piège
des oléorésines peut rapporter une multitude de champignons
- moisissures. Certains fossiles baltes (mais pas seulement) démontrent
que les gemmes antiques (pas encore totalement polymérisées)
ont parfois été colonisées par ces organismes vivants.
Voyage au monde étrange des filaments et champignons dans l'ambre...Ci
dessus, voici trois espèces de champignons de l'ambre de la Baltique
(Eocène) décrites par Berkeley (1848). De gauche à
droite : Penicillites curtipes, Brachycladium thomasinum, Streptothrix
spiralis. Les dessins sont représentés sur un bois contemporain
(Photo Eric Geirnaert) couvert de champignons.
|
Le voyage d'exploration des
filaments fongiques
et des "machins" plus ou moins bactériens
est infini dans l'ambre...
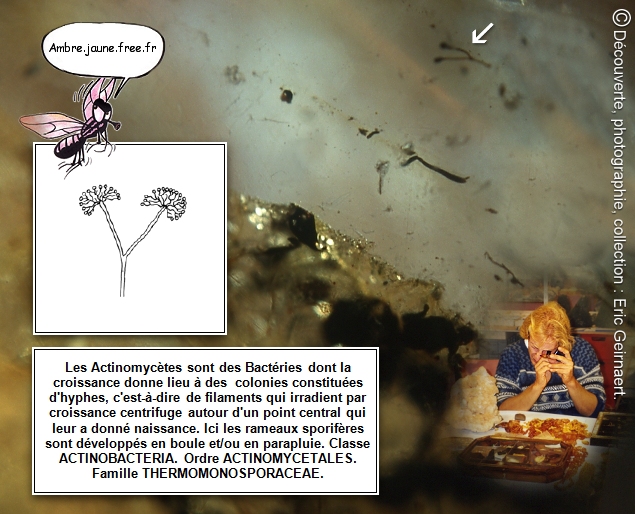
La "mycoflore"
fossile des ambres composée surtout d'ascomycètes mais pas seulement.
Les champignons de l'ambre.
La
plupart des champignons (petits champignons charnus sur
pieds et autres moisissures, tel que nous l'entendons) sont des organismes
qui, imprégnés d'eau, sont altérables au moindre
choc... Amorphes, fragiles, éphémères et mous, ne
vivant d'ailleurs que quelques jours complètement développés,
les petits champignons sont sensibles au chimisme de la résine
et sont, de fait, de très mauvais acteurs de la scène d'ambre.
Et, pourtant ils devaient être nombreux et bien distribués
dans le paléo biotope de la forêt humide...
Les rares découvertes de champignons émerveillent les mycologues !
Sans ambre, pas le moindre indice exploitable sur la présence éventuelle
des champignons antiques. Exception faite de quelques traces dans les
grès (à Álava) dans le nord de l'Espagne, il n'y
a que l'ambre pour restituer les premiers champignons. Mais, découvrir
un champignon de l'ambre, cela se mérite...
C'est en travaillant précisément
les paramètres (d'un
nouveau procédé d'exploration) de la prise d'image des
inclusions organiques de l'ambre que l'on peut révéler les
détails de quelques champignons diaphanes, lesquels, sont pourtant
de précieux bio indicateurs du palé biotope. Cependant l'incertitude
de la datation des échantillons, les données fragmentaires
sur le support, le mauvais examen des séries -où les fossiles
font surtout défaut- rend difficiles les descriptions phylogénétiques
ainsi que les aires cosmopolites des aires de paléo distribution.
Mais, peu importe la difficulté. Révéler de si précieuses
inclusions est un voyage de contemplation qui rivalise de beauté
avec l'histoire merveilleuse de raconter les populations entomologiques
de la forêt d'ambre.
Tandis que le web devient payant,
tandis qu'il faut payer avec sa carte bancaire pour consulter un article
(où n'apparaissent pas les images !), offrons nous GRATUITEMENT
sur Ambre.Jaune un "Voyage pédagogique" au pays des champignons
de la forêt d'ambre !
|
Pièce
unique TRE RARE, un
champignon
charnu dans l'ambre birman (100 M.A.)

Bon... Ci-dessous, toutes
ces masses rondes (selon les
spécialistes) seraient des petits champignons...
Oui mais NON... Regardons la chose.
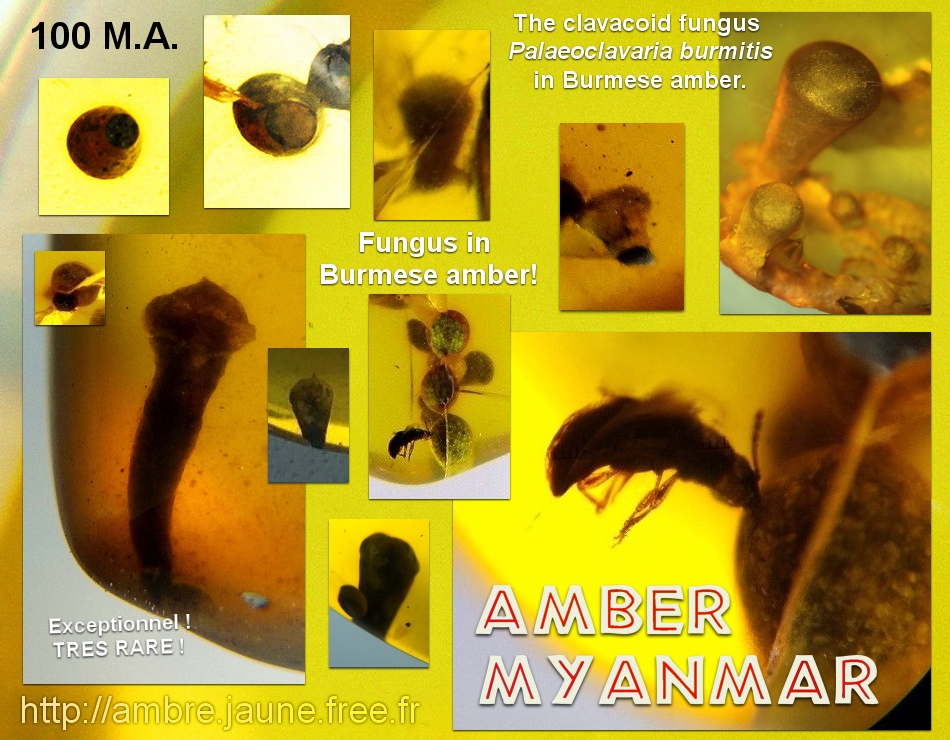
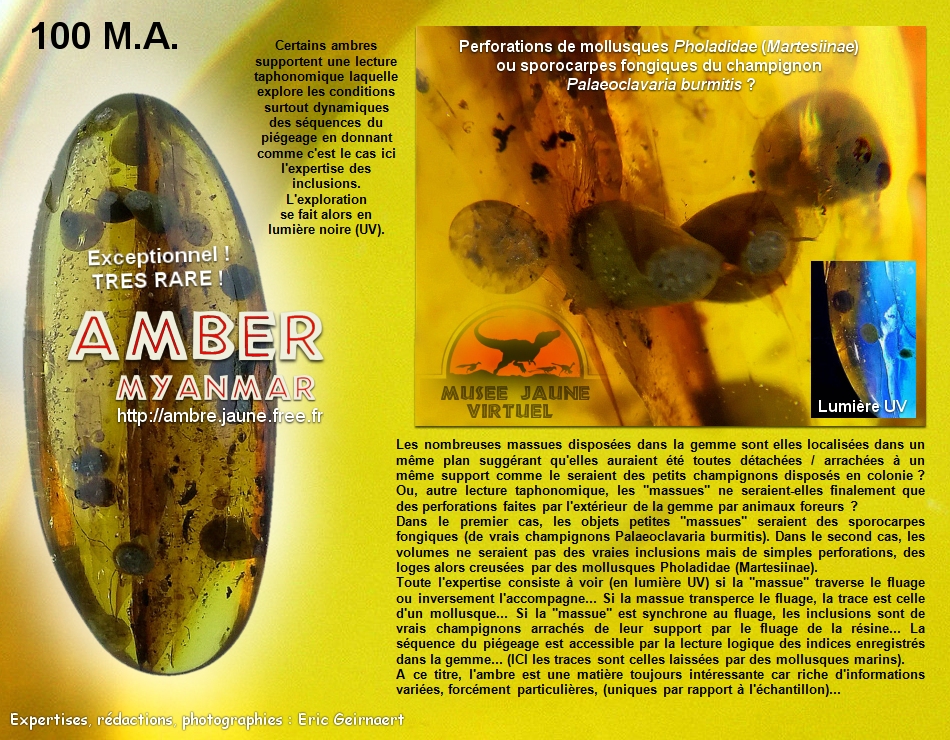
Alors, observations faites,...
ces petites massues
seraient (toutes) des champignons?
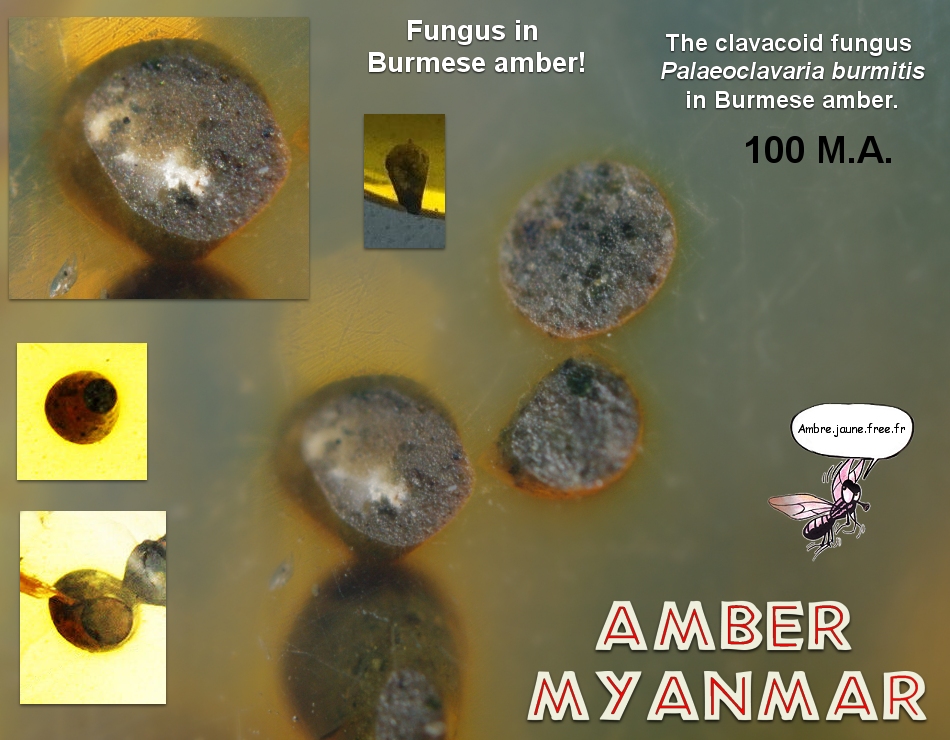
Non,
ce sont des
mollusques marins...
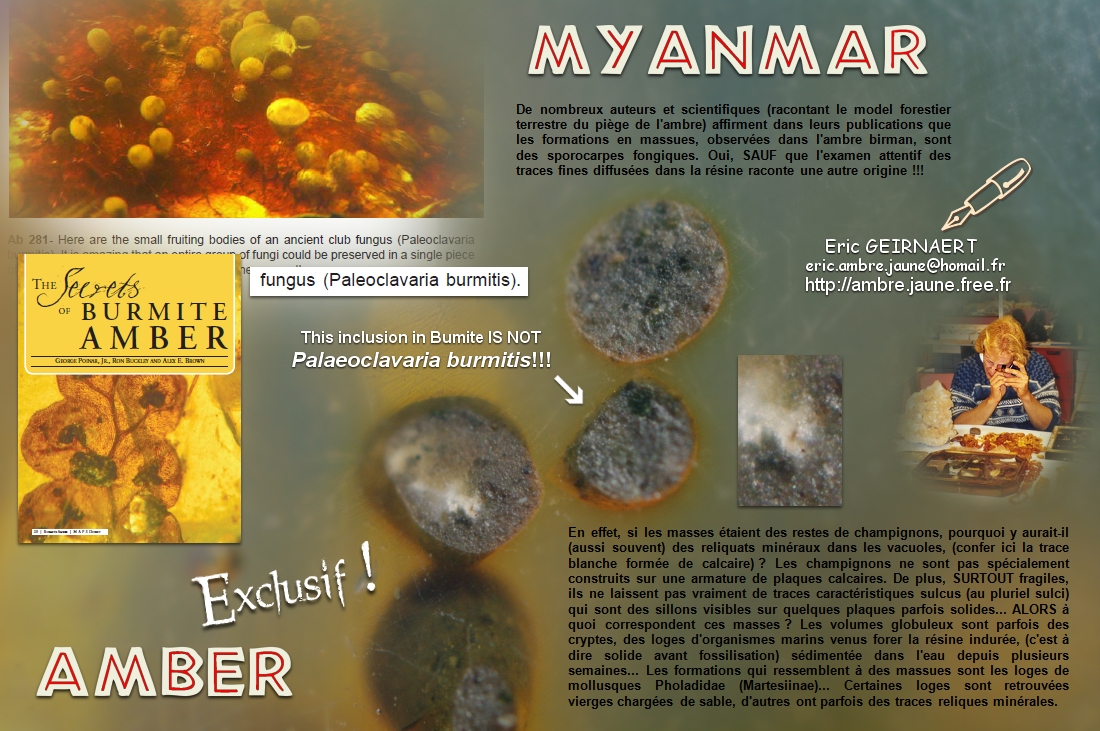

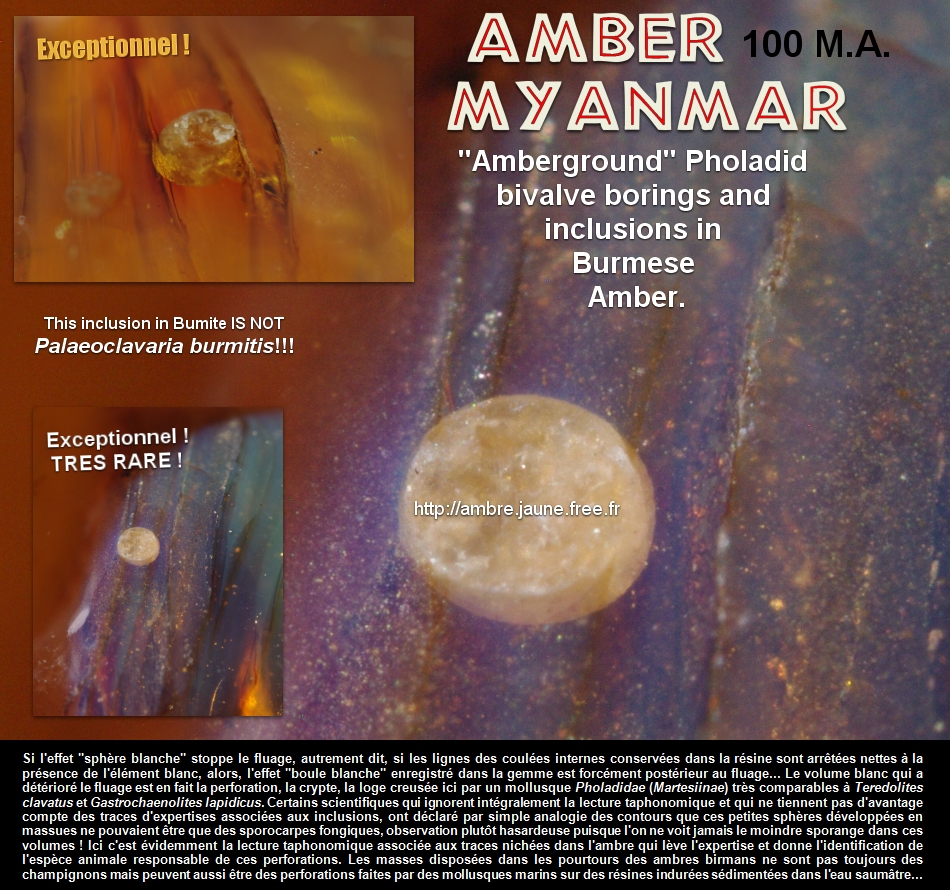
|
L'ambre
crétacé birman (100 M.A.), ci-dessus, a des
propriétés optiques surprenantes souvent plus
marquées que celles du succin balte (40 M.A.). Certains échantillons
amenés au soleil zénithal montrent un effet "bleuissant"
des surfaces qui n'est rien d'autre que la fluorescence naturelle (originelle)
visible de jour ! Observer une fluorescence
en lumière blanche de jour est plutôt rare dans la nature !
Cela tient ici à l'imprégnation remarquable de composés
végétaux (comme des hydrocarbures contenant à l'occasion
du pérylène identifié dans le matériel dominicain)
dans la matrice profonde des oléorésines fraîches
avant induration puis fossilisation. La fluorescence est initiée
par des apports végétaux ce que démontre cette inclusion
ronde" (inerte) qui apporte un ilot épargné par son
volume incrusté resté inexpressif... La vacuole ronde a
été formée par un mollusque marin Pholadidae
(Martesiinae)...
L'ambre joliment coloré ci-dessus est une réponse de fluorescence
en lumière blanche au soleil et le la vacuole rapportant sans doute
quelques impuretés minérales répond d'un éclat
blanc. L'éclat blanc dans le volume de l'ambre résulte de
l'interaction des petites particules minérales qui renvoient intégralement
la lumière du soleil. La vacuole n'a donc pas de réponse
en fluorescence...
|

En forme d'entonnoir,
assise ronde soutenant un réceptacle lisse, l'inclusion
balte, ... n'est pas une fleur... Ce n'est pas non plus, ... un insecte.
Bref, c'est quoi ?
Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (juin 2000).
|
Classification
évidemment perfectible, rangés ici dans le site web
Ambre.jaune, dans le registre des inclusions associées à
l'eau, les champignons de l'ambre apparaissent surtout dans les biotopes
forestiers, (mais proches d'un delta ou sur l'estran de la presqu'île
d'un site) où apparaissent, étrangement, ... de TRES nombreuses
traces d'eau...
D'un point de vue numérique,
en nombre d'inclusions trouvées par lot de brut examiné,
les mycètes de l'ambre semblent effectivement associées
aux inclusions d'un micro biotope aquatiques ou semi aquatique où
existent quelques protozoaires, des micro algues, quelques flagellés
et des protozoaires parmi une entomofaune bien distribuée et surtout
inféodée au biotope d'eau, au moins pour les larves...
Dit autrement : 'dans ce lot où apparaissent quelques insectes
qui venaient pondre, les traces de champignons sont très nombreuses'...
|

En forme de
coupe régulière ouverte et qui ressemble alors à une corne
d'abondance
(ou une trompette), ce magnifique champignon balte, 10 mm, partiellement
digéré par la résine, est une mention unique d'une espèce
jamais référencée.
Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (juin 2000).

Heu... Fungus ??? Ou pas
"FUNGUS"...
Ce
qui semble être (ci-dessus) un champignon en forme de corne
d'abondance pourrait bien être autre choses... Et, l'expertise ne
se fait pas spécialement sur l'inclusion à proprement parler,
mais, sur la lecture logique des traces associées et dispersées
dans la gemme. En suivant les traces, d'ailleurs concordantes dans plusieurs
ambres du même lot, en tenant un
exercice de taphonomie, on peut découvrir que le cône
est le bol
desséché d'une ancienne "fleur"...
|
Heu... Fungus ??? Ou pas
"FUNGUS"... Donnons
l'interprétation de la chose :


Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).
|
La
présence des champignons dans l'ambre jaune est attestée
par de très rares fossiles, (comme ci-dessus), qui correctement
"analysés", pourraient laisser penser que certaines
espèces étaient colorées (présence de pigments
"conservés" dans la gemme d'ambre ?)...
|
Voici le détail d'une inclusion minuscule et fragile...
Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Le petit champignon aura-t-il été arraché
de son support à la suite d'une
tempête, qui, temporairement aura bouleversé les données
du
biotope, -où d'ailleurs l'assemblage de traces de plusieurs
bois fossiles devrait permettre de comprendre
d'avantage la situation précise du site-.
Petits
"ballons" montés sur des pieds droits, certains champignons
comme les Aspergillus sont de véritables raretés de l'ambre.
Ces champignons filamenteux (imparfaits) sont rattachés à la classe
des champignons Deutéromycètes.
Les petites moisissures saprophytes, sur
pied, (ici minuscules, et, associées à un biotope humide), sans
doute présentes partout dans la forêt d'ambre, sont rares, très
rares en inclusions... Ces champignons impliqués dans de nombreuses pathologies
ne sont pas corrélés à un affaiblissement (théorique)
des arbres antiques dont la réponse physiologique aurait été
matérialisée par une sécrétion excessive de résine
(désignée sous le nom de succinose). LA CHOSE LE PLUS INTERESSANTE
A NOTER EST QUE CES CHAMPIGNONS Ascomycètes SEMBLENT S'ETRE DEVELOPPE
et AVOIR MEME COLONISE LA GEMME DE RESINE (L'INTERIEUR PROFOND DE LA MATRICE)
-traversant le fluage des coulées, pénétrant parfois les
épaisseurs profondes- tandis que les sécrétions étaient
amassées et figées dans la litière plus ou moins inondée
du biotope antique. La présence des champignons
n'est pas un piégeage par la résine mais UNE COLONISATION PROFONDE
des matières par l'espèce vivante. La colonisation des gemmes
par plusieurs familles de champignons, des moisissures (quelques algues et parfais
des animaux cellulaires) est parfois étonnante !

De la classe des Ascomycètes,
de l'ordre des Eurotiales, les Aspergillus sont des champignons
filamenteux, de type moisissure, (difficiles à repérer dans l'ambre)
dont la colonie se présente, comme ici, sous forme duveteuse... Ces champignons
n'apparaissent sur la matière carbonée qu'en décomposition...
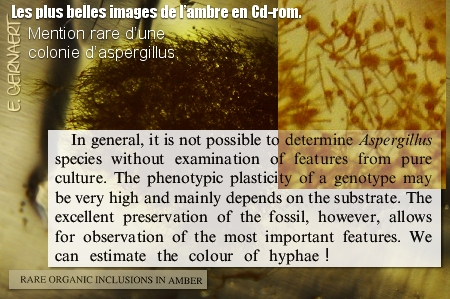
En examinant -en détail- les inclusions
fossiles, on peut supposer que quelques spécimens antiques (à
croissance rapide car plusieurs morphes synchrones apparaissent dans quelques
échantillons d'un même lot) pouvaient probablement être colorés.
Exception faite de cette mention unique d'une moisissure restée colorée,
(photo ci-dessous), les couleurs vives -et sans doute variées- des spécimens
antiques retrouvés dans l'ambre (surtout au niveau des conidies, = spores
assurant la multiplication asexuée des champignons) ont été
dénaturées par le chimisme de la résine. On connaît
environ 200 espèces d'Aspergillus actuels. Le thalle cloisonné,
(formé de nombreuses conidies, formant la "tête aspergillaire")
est porté droit sur un petit pied particulièrement fragile aux
attaques de la résine. Les Aspergillus sont ubiquistes, cosmopolites...
Et, constituent surtout des inclusions précieuses pour le collectionneur,
(=humour).
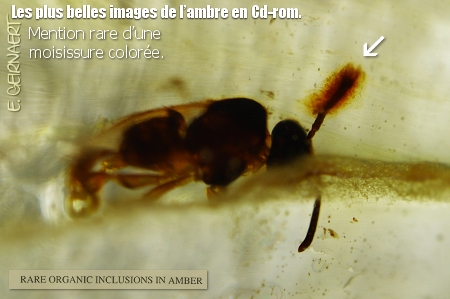
Ces moisissures (rarement colorées),
ici repérée sur l'antenne d'une petite abeille sans aiguillon,
se développent souvent sur la matière organique morte et semble
croître dans le milieu piège de la résine fraîche.
Les filaments, très fins, grandissent et traversent tant les structures
organiques du support que les coulées de la résine. La coloration
de cette mention n'est rigoureusement pas un artefact...
L'ambre colonisé
par des moisissures ! Voici une autre inclusion de l'ambre pouvant facilement
passer inaperçue...

Autre inclusion pouvant facilement passer inaperçue,
voici des moisissures (Beauveria ?) sur une dépouille animale
du plus grand intérêt !
De fines moisissures (qui se sont développées sur la larve
d'insecte) accompagnent parfaitement le fluage blanc, lequel, est une
réaction
de dégazage née à partir des liquides corporel de l'animal.
Le développement de ces moisissures s'est donc
réalisé dans la
gemme de résine ! Tombée de l'arbre, après
sa vie aérienne, la résine a donc été colonisée
par des champignons.
L'ambre a été "colonisé" par des moisissures.
Les moisissures n'ont pas été "attrapées" (au
petit bonheur la
chance) par le piège aérien. Non, les moisissures se sont développées
juste avec la capture de
l'insecte puis quelque temps en profondeur dans la gemme végétale
sur le corps animal.

De
nombreuses petites moisissures et champignons devaient exister dans la forêt
d'ambre (dont on notera que le climat devait être chaud et humide). Cependant,
les références mycologiques retrouvées dans l'ambre sont
rares.
Cette magnifique larve de coléoptère (nimbée dans un son
halo blanc de dégazage, signature avérée d'un matériel
balte qui réagit à l'humidité) est recouverte d'une moisissure
blanche particulièrement fine et surtout difficile à examiner.
L'avantage de photographier les inclusions organiques à partir du matériel
brut conservé en volume 3D est de pouvoir aller chercher les angles
intéressants des meilleures prises de vue, (3 sont présentées
ici) ce que ne permet pas le montage des inclusions en lames minces.
Il est intéressant de supposer (c'est
une hypothèse) la rapide colonisation de la moisissure sur le substrat
mort. On notera qu'à l'arrière de l'abdomen, la larve de coléoptère
est piégée avec de nombreuses portions de bois et particulièrement
des feuilles et des tiges (d'espèces aquatiques?). La petite moisissure
devait peut-être déjà exister du vivant de l'insecte, se
développant alors, sans doute, sur des feuilles endommagées qui
devenaient nécrotiques. Cachée dan le halo blanc, ces petites
formations filamenteuses blanches ressemblent assez à des à des
champignons Beauveria, champignons imparfaits filamenteux appartenant
à la classe des Deutéromycètes. Le Beauveria
regroupe quatre espèces saprophytes ou parasites et entomopathogènes.
Les colonies sont cotonneuses à poudreuses, généralement
de couleur blanche ou jaune pâle à rose pâle.
Cette larve d'insecte, (sans doute un coléoptère),
couverte de champignons, certes, pas très "esthétique"
(pour une collection) est cependant extraite du cd-Rom Ambre qui regroupe
un large panel des belles et rares inclusions. C'est surtout la technique photographique,
qui offre la possibilité d'aller chercher les indices infimes cachés
dans la résine. Présenton deux autre cas, où l'image va
chercher le thorax d'un diptère, puis, le dos d'un psoque...
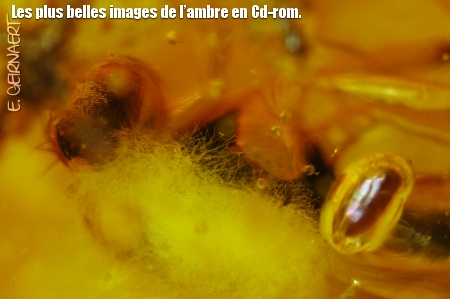
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).
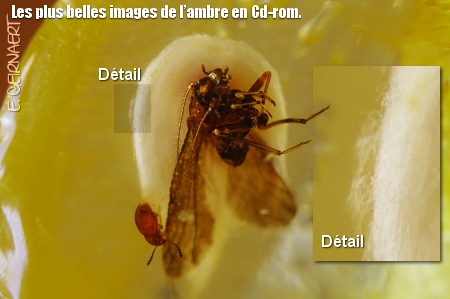
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).
Après les mosissures fines, -difficiles
à examiner-, observons maintenant des petits amas globuleux et ramifiés,
(plus sombres) piégés dans l'ambre, qui ressemblent à des
lichens.

Inclusions globuleuses, ramifiées,
souvent associées à des insectes mais
qui restent difficiles à déterminer avec précision...
De la classe des Ascomycètes,
ces formations ovoïdes, parfois globuleuses, en colonies duveteuses, qui
apparaissent de couleur grise à vert olive, pourraient être des
Chaetomium ? On notera des poils simples ou ramifiés, raides,
(ondulés ou parfois spiralés) qui résistent assez bien
à la force du flux de la déformation par l'écoulement de
la résine. Sans doute ubiquitaires et assez communes dans l'environnement
de la forêt de résine, ces formations globuleuses ramifiées
sont souvent associées à des insectes, et, peut-être phytopathogènes,
pouvaient-elles être impliquées dans diverses infections.
Tandis que l'Université de Cornel
nous explique le potentiel formidable que constitue la découverte d'un
champignon Aspergillus sur un collembole de l'ambre, (fossile entreposé
au musée Smithsonian), présentons un collembole de l'ambre
(ci dessous) parasité par des champignons fossiles d'espèces non
documentées ?! Il est probable que ces champignons antiques, (peut-être
saprophytes ?), puissent avoir été parasites d'insectes vivants...
Au regard du potentiel formidable de ces fossiles rares, qui émerveillent
les spécialistes, présentons quelques spécimens issus de
ces lots d'ambres bruts où les traces d'eau et d'humidité du paléo
biotope sont nombreuses.
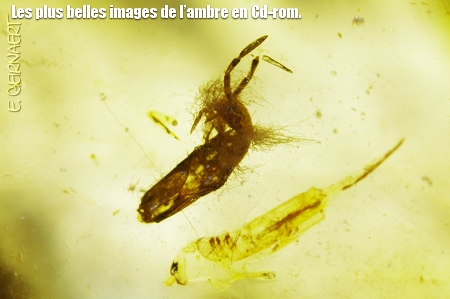
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).
Le champignon, c'est le label de prestige
de la belle collection !
A ce jour, tous gisements confondus, (Eric
G. 2002), la plus vieille inclusion identifiée est celle d'un champignon
dans un ambre anglais du Carbonifère (Smith 1896). Cet ambre, connu sous
le nom de Middletonite, a été trouvé dans le district de
Kilmarnock. En plus du pollen et de différentes portions incomplètes
de fleurs de conifères, l'échantillon contenait un fossile de
champignon du plus grand intérêt (dans une nouvelle espèce
et dans un nouveau genre, et, même dans un ordre inédit). La seconde
inclusion, toujours en terme d'ancienneté, est encore un champignon trouvé
dans un ambre triasique allemand (Carnien 125 M.A.).
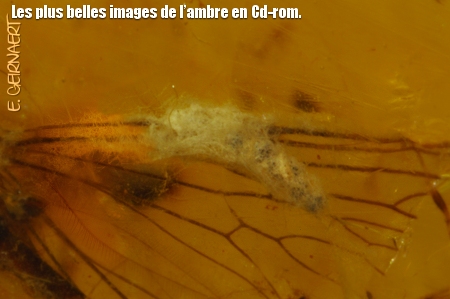
Quelques mycètes fossiles peuvent être référencés
dans l'ambre, car plusieurs
espèces se développent à l'extérieur des insectes,
enveloppant les organes.
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).
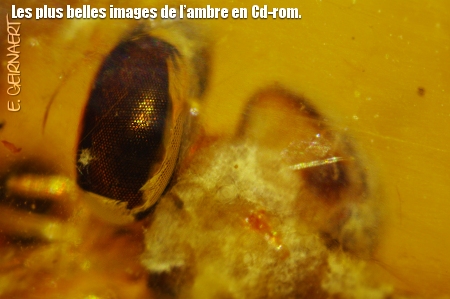
Mais, certaines espèces se développent à l'intérieur
des insectes et traversent
la cuticule comme cela apparaît sur les yeux à facette de ce diptère.
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Le champignon se développe
à l'intérieur de la pupe de cet insecte et
traverse la cuticule pour croître, quelques temps, dans la résine
fraîche.
Découverte,
Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (octobre 2010).
Cette dernière découverte
est surtout intéressante car elle montre (démontre?, ou plutôt
semble indiquer) que les filaments se sont développés dans la
résine fraîche (encore tendre, = non indurée) en franchissant
sans déformation les coulées de résine déjà
déployées sous le poids de la pesanteur. Là où l'insecte
meurt par étouffement, le champignon semble pouvoir se développer
quelques temps dans le milieu piège de la résine en progressant
libre dans la gemme ?... Ces observations difficiles dans la résine
ont été rendues possibles par l'invention d'une nouvelle méthode
d'observation non destructives des échantillons, -méthode bientôt
présentée en article dans la presse avec une version cd-rom de
la photothèque AMBRE-.
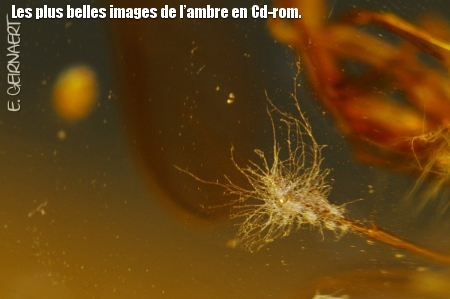
Voici
un champignon qui semble s'être déployé "librement"
-sur une patte de moustique-
sans déformation du fluage par la contrainte des forces exercées
par le
poids du flux de la résine qui roule en coulées successives...
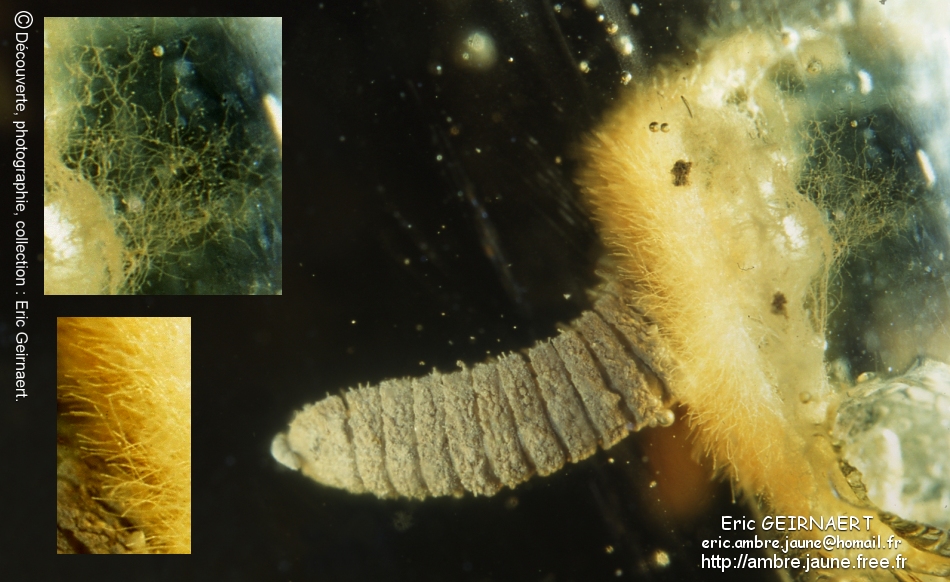

En examinant les petites inclusions de l'ambre, il semble que
l'on puisse
avoir la preuve de la colonisation de la gemme tendre
-avant induration- par des espèces vivantes !
Revenons à
cette hypothèse où le champignon filamenteux pourrait
se développer quelques temps, dans le milieu piège de la résine
encore fraîche. La lecture taphonomique du fossile démontre le
fait.
Une lecture taphonomique du fossile démontre
que le champignon A1 (au premier plan) s'est déployé dans le milieu
stabilisé (immobilisé) alors que celui avait précédemment
étiré le champignon A2 dans la direction des forces qui d'ailleurs
ont modifié la position des insectes comme l'indique l'aile ouverte du
diptère B, en arrière plan. Collé au tronc de l'arbre -déjà
dans la résine?-, le champignon A2 a été déformé
par le mouvement du flux de la résine sous le poids de la pesanteur.
Puis, la résine tombée au sol -donc figée- a laissé
vierge le déploiement libre du champignon A1... La lecture taphonomique
de la gemme donne la chronologie logique du fossile et démontre effectivement
qu'un champignon progresse dans le milieu piège resté tendre.
La taphonomie
d'un champignon !
Comment interpréter
le fossile ci dessous :
un petit panache étrange attenant à un insecte est déformé
par le fluage tandis
qu'un second, attaché au même insecte, est rayonnant... La découverte
d'une inclusion mycélienne dont la
croissance est rayonnante (sur une dépouille animale déjà
roulée par le fluage) constitue
une preuve irréfutable d'un développement retardé.
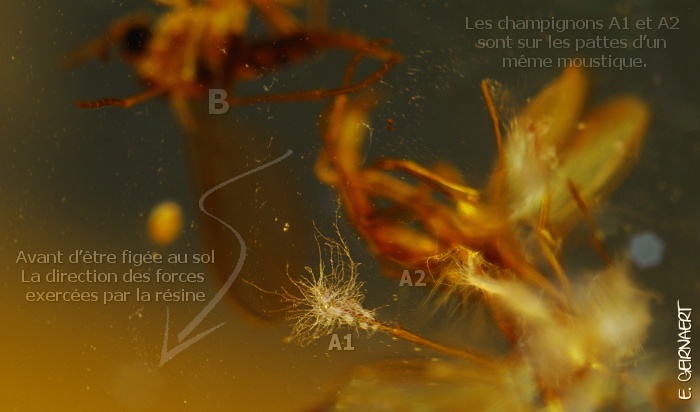
Le petit
fossile avec moisissures double orientations dans un même fluage, une
rareté !
Les champignons A1 et A2 sont sur les pattes d'un même moustique et,
pourtant, ils ne sont pas affectés par
les mêmes déformations plastiques... Le champignon A1 s'est développé
(après A2) sans
doute lorsque la résine fraîche, tombée au sol, était
figée...
|
Le
développement d'organismes vivants dans l'ambre serait un conte
de fée ?!
Selon certains
internautes qui se mêle de commenter et critiquer sans cartouche,
le développement d'organismes vivants dans l'ambre serait un conte
de fée ! Un confrère me disait récemment :
Ce qui me sidère c'est que ceux qui n'ont rien à présenter,
n'ont rien écrit ou photographié se mêlent de commenter
et critiquer sans cartouches. C'est comme souvent "les cons osent
tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît"
(Lino Ventura).
Le développement d'organismes vivants dans l'ambre (avant fossilisation),
n'est pas un conte de fée !
Et, pour éclairer le sujet,
commentons cette photographie, présentée, ci-dessus.
Dans un même fossile d'ambre,
sur un moustique somme toute assez commun, plusieurs amas de moisissures
présentes aux pattes suivent le flux d'ondes de la résine,
laquelle, coule sous l'effet de la pesanteur en étirant les filaments
vers le bas et la gauche de l'image comme cela est visible en A2.
Mais, chose REMARQUABLE, sur le dit
moustique (qui apparaît flou sur le bas à gauche de l'image,
-excusez le cliché, l'image souhaite surtout montrer les moisissures-)
la patte médiane au point A1 montre une moisissure qui semble s'être
développée de façon radiale, -dans toutes les directions-
en ignorant les forces de la résine !!! C'est comme si ce développement
de moisissure ignorait le fluage surtout efficient au point A2. Alors
pourquoi un tel paradoxe? Le développement radial d'une moisissure
qui gagne le milieu piège dans un axe de croissance non-conforme
au fluage (d'ailleurs enregistré par les mêmes moisissure
sur le même insecte) suggère une chronologie des évènements
où l'organisme vivant qu'est la moisissure semble avoir colonisé
la résine encore plastique mais immobilisée sans doute dans
les roches encaissante du dépôt. Ce fossile qui existe en
tant que tel, où deux directions apparaissent pour la progression
des moisissures, est une preuve que des organismes vivants peuvent coloniser
la résine pendant le fluage et quelque temps après.
Preuve est donnée
par cette référence intéressante que des organismes
vivants peuvent se développer vivants dans la gemme (avant induration).
Oui, des moisissures peuvent croître dans la résine tendre,
qui, bientôt durcie par la diagenèse bloque tout développement
de croissance. Certains ambres colorés (anormalement) semblent
avoir été imprégnés par des pigments d'organismes
colonisateurs (algues bleus, pigments de champignons). Le panache d'une
moisissure qui traverse les flux d'ondes de la résine ignorant
le fluage antérieur fait penser un peu aux racines d'un arbre qui
transpercent les couches sédimentaires profondes éventuellement
déformées du sol. Le panache de moisissure A1 s'est développé
après l'effet fluage (déformation lente par la contrainte
du mouvement fluide) et a profité des liquides viscéraux
de l'insecte. Le développement d'un organisme vivant dans le milieu
piège est donc démontré par une lecture taphonomique
sur un fossile. Nous ne sommes pas ici au niveau de l'hypothèse
mais des faits. Raconter le fossile dans une lecture taphonomique n'est
pas une hypothèse, c'est un exercice de pure logique. La résine
antique que l'on pensait une matière piège étouffante,
(actualisme oblige) a laissé croître des organismes vivants
dont la progression est occasionnellement significative dans une lecture
taphonomique! Ce fossile très utile à la démonstration
atteste que des organismes vivants peuvent coloniser une gemme encore
tendre à l'origine de l'ambre. Ce fossile bouleverse nos idées
dogmatiques du milieu piège de l'ambre.
Je suis surpris que l'on n'apporte
pas plus d'intérêt aux lectures logiques des indices taphonomiques
des inclusions organiques. Les travaux publiés se limitent trop
souvent aux descriptions morphologiques des types nouveaux. Mais, des
choses simples comme les positions des objets sont souvent ignorées.
Et, il faut une redoutable précision optique pour aller chercher
les moisissures diaphanes dans des ambres conservés en volume 3D.
Si vous débitez les ambres en lames minces, vous risquez de passer
à coté de belles découvertes. Certaines algues aquatiques,
des moisissures aériennes semblent avoir été capables
de coloniser les résines antiques. Cette découverte complète
le travail de lecture de certains auteurs qui admettent enfin des "perméabilités
biotiques" (certes limitées dans le temps) à des organismes
dénués de force physique mais qui apparaissaient parfois
profonds dans la gemme ! Attention, croissance, ne veut pas dire
présence ! Trouver une inclusion organique couverte de moisissures
ne permet pas forcément de démontrer la croissance post-mortem !
Une seule référence parmi une centaine d'observations permet
dans ma collection de développer la démonstration taphonomique.
|
Pour ceux qui souhaiteraient suivre l'étude
des champignons de l'ambre rappelons (Eric G. 2002) que l'apparition des premiers
conifères fournit des débris sporadiques de résines d'âge
carbonifère... Et, ces premières sécrétions fossiles
ont permis de découvrir en Angleterre, la toute première inclusion
du Paléozoïque, il s'agit d'un champignon (Smith, 1896).
Comment mieux finir cette présentation
(non exhaustive) des champignons de l'ambre qu'en présentant UNE MENTION
UNIQUE? Cette image montre le développement de champignons mycètes
de l'ambre qui participent à la putréfaction d'une portion de
cadavre. Le champignon se développe sur une section d'un doigt de lézard
et accompagne le mouvement du flux de la résine avant fossilisation en
ambre. Avec la découverte de sang fossile coulant d'une dépouille
(=dépouille sanguinolente, voir
le sang fossile  )
cette mention d'un champignon saprophyte qui envahit un cadavre EST UNE DECOUVERTE
EXCEPTIONELLE !
)
cette mention d'un champignon saprophyte qui envahit un cadavre EST UNE DECOUVERTE
EXCEPTIONELLE !
La putréfaction
de dépouilles de vertébrés par des champignons n'a jamais
été examinée dans l'ambre. Cette inclusion est une mention
unique.
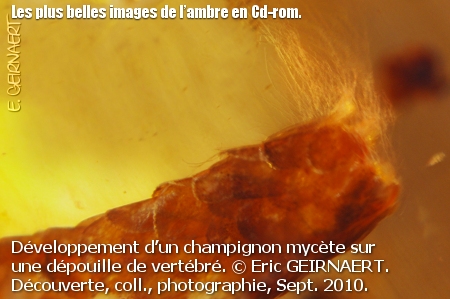
Ces filaments mycéliens,
actinomycètes?, d'un intérêt considérable,
ne
pourraient-il pas constituer la base d'un article de science ?
Découverte, Collection et Photographie :
Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

-Dear Eric,The threads look like fungae mycelia. Best regards. Joerg
Wunderlich.
-Hi Eric,These look like fungal filaments to me. David
Penney.
-I think it is either fungal hyphae or filamentous bacteria, both being common
on dead organic material.
These filaments probably started to grow on the vertebrate remain and grew into
the liquid resin
for a while before solidification occured. Is this Baltic amber?
With best wishes, Alexander R. Schmidt.
|
Commentaire
de l'inclusion.
Désignés en
anglais de Ray fungi, (soit rayonnants champignons)
ou "Champignons à rayons" les Actinomycètes sont
des bactéries en colonies dont les structures constituées
d'hyphes évoluent par croissance centrifuge à partir de
la spore d'origine. L'organisme général se matérialise
alors par des filaments, très fins, de quelques microns de diamètres.
Ces amas filamenteux centrifuges se développent dans la matière
organique en décomposition. Ubiquistes et pionnières, ces
bactéries filamenteuses peuvent se déployer dans des milieux
les plus hostiles, et, la découverte unique de cette mention rare
sur une dépouille de vertébré de l'ambre, montre
sans conteste que le feutrage existait à l'air libre (sur la dépouille)
avant d'être englué et piégé en profondeur
dans la résine non indurée.
|
Et, déjà
une seconde découverte dans le même lot de brut !
Autres développements mycéliens d'un très grand
intérêt sur l'épiderme et la dépouille d'un lézard.

Découverte,
Collection et Photographie :
Eric GEIRNAERT, (octobre 2010).
D'autres inclusions fossiles
seront
bientôt présentées dans cette page web.

Vous avez
une question, vous souhaitez avoir une expertise gratuite de vos inclusions.
Vous pouvez participer au Forum

Pour approfondir
l'étude des champignons de l'ambre, voici quelques mentions bibliographiques :
- George O. Poinar, Jr. and Rolf Singer. 1990.
Revue Science Vol 248 Juin. Upper Eocene Gilled Mushroom from the Dominican
Republic. (p 1099-1101)
- Benjamin M. Waggoner, 1994. Journal of Paleontology.
Volume 68, No. 2Mars. pp. 398-401. Fossil Actinomycete in Eocene-Oligocene Dominican
Amber
- D. S. Hibbett, D. Grimaldi, M. J. Donoghue. 1995.
Revue Nature Vol 377 Octobre. Cretaceous mushrooms in amber. (p 487).
- David S. Hibbett, David Grimaldi and Michael J. Donoghue. 1997.
American Journal of Botany 84(8): 981-991. Fossil Mushrooms from miocene
and cretaceous ambers and the evolution of HOMOBASIDIOMYCETES.
- Poinar, G.O. 1998. Fossils Explained 22:
Palaeontology of amber. Geology Today 14(4): 154-160.
- Hughes, M. et al. 2004. Stigmatomyces
from New Zealand and New Caledonia: new records, new species and two new host
families. Mycologia 96(4): 834-844.
- Darfelt, H.
and Schmidt, A.R. 2005. A fossil Aspergillus
from Baltic amber. Mycol. Res. 109(8): 956-960.
- Poinar Jr., G. Poinar, R. 2005. Fossil
evidence of insect pathogens. Journal of Invertebrate Pathology 89: 243-250.
- Carmen Ascaso, Jacek Wierzchos, Mariela Speranza, Juan Carlos Gutiérrez
, Ana Martín González , Asuncion de los Ríos and Jesús
Alonso. 2005. Revue : Micropaleontology, Volume
51, No. 1, pp. 59-72. Fossil Protists and Fungi in Amber and Rock Substrates.
- Rossi, W. et al. 2005. A new species of
Stigmatomyces from Baltic amber, the first fossil record of Laboulbeniomycetes.
Mycol. Res. 109(3): 271-274.
- Poinar, G.O. and Buckley, R. 2007. Evidence
of mycoparasitism and hypermycoparasitism in Early Cretaceous amber. Mycol.
Res. 111(4): 503-505.
- Hibbett, D.S. et al. 2007. A higher-level
phylogenetic classification of the Fungi. Mycol. Res. 111(5): 509-547.
Un
dossier (PDF) relatifs aux coléoptères qui mangent le champignons
au Crétacé.
Un
dossier (PDF) relatif aux champignons trouvés dans l'ambre.
Un
dossier (PDF) relatif aux champignons carnivores de l'ambre Crétacé.
Un dossier (PDF)
concernant le plus vieux fossile de champignon.
Un
dossier (PDF) concernant les fossiles de champignons originaire de l'ambre
du miocène et du crétacé et l'évolution des HOMOBASIDIOMYCETES.
- ©
2002 Ambre.Jaune -
Contact E-mail Auteur : eric.ambre.jaune@hotmail.fr