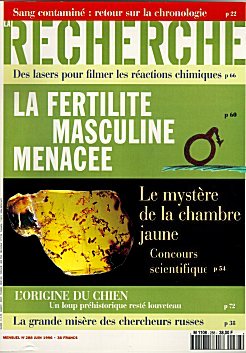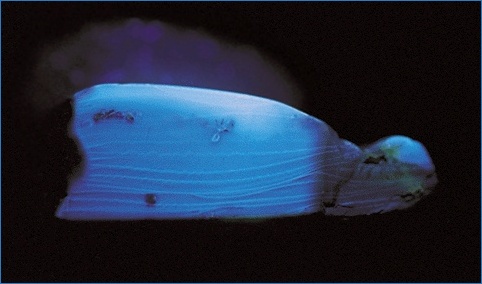Le
mystère de la chambre jaune
(suite et fin)

Des fourmis, plus stressées
que d'autres, sous une pluie de résine
Jorge
Wagensberg, C. Roberto F. Brandão et Cesare Baroni Urbani
La
Recherche, n° 298, mai 1997
 Note
: reportez-vous aux documents originaux pour profiter des nombreuses figures
et images auxquelles le texte se rapporte. Note
: reportez-vous aux documents originaux pour profiter des nombreuses figures
et images auxquelles le texte se rapporte.

Trois
centimètres de côté. Vingt-cinq millions d'années.
Il y a quelques mois, nous vous proposions de jouer les chercheurs éthologues
en nous envoyant le scénario le plus probable ayant conduit à
l'emprisonnement de 88 fourmis dans un petit morceau d'ambre surnommé
«Jorge Caridad».
Le gagnant de ce thriller scientifique, monsieur Éric Geirnaert,
est un collectionneur d'ambre, entomologiste amateur. La pièce
d'ambre «Jorge Caridad» nous livre aujourd'hui son mystère.
En juin 1996, nous publiions dans
ces pages un article intitulé «Le mystère de la chambre
jaune» et invitions les lecteurs de La Recherche à
proposer des solutions à une énigme quelque peu insolite.
Il s'agissait d'un exercice véritablement interdisciplinaire
puisqu'il requérait, comme nous allons le voir, des connaissances
en entomologie, en physique des matériaux, en chimie, en statistique
et en éthologie. Connaissances auxquelles il était utile
d'ajouter une certaine dose de bon sens, qualité toujours bienvenue
et fort appréciée en archéologie, en paléontologie
et plus généralement chaque fois qu'il s'agit de reconstituer
des événements enfouis dans le passé.
La
question posée était simple : quel scénario
avait conduit il y a vingt-cinq millions d'années des fourmis à
se retrouver prises au piège dans la pièce d'ambre baptisée
«Jorge Caridad» ? Nous vous proposions de reconstruire
ce scénario à partir de l'observation attentive de cette
pièce et de la lecture de la première partie de notre article.
Voici,
présentée en onze étapes, notre reconstitution
de l'histoire de «Jorge Caridad».
 Première
déduction : 82 fourmis sont de la même espèce
et appartiennent à la même colonie. Première
déduction : 82 fourmis sont de la même espèce
et appartiennent à la même colonie.
Ces fourmis se ressemblent beaucoup et se trouvent toutes dans la même
couche. Pour s'en persuader, il suffit d'observer les détails morphologiques
de ces 82 individus ainsi que les photos. Il est probable que tous ces
individus appartiennent non seulement à la même espèce
mais aussi à la même colonie car la scène relate des
événements simultanés. La pièce contient-elle
un seul et unique épisode historique ? Non : les couches les
plus voisines du sol contiennent d'autres insectes (deux fourmis appartenant
à une autre espèce) probablement piégés dans
la résine avant l'événement principal tandis que
les couches supérieures de la pièce renferment des insectes
(moustique, nymphe de mante...) piégés plus récemment.
L'analyse chimique de l'ambre fait remonter les faits à environ
vingt-cinq millions d'années.
 Deuxième
déduction : la face A de la pièce touche le sol, la
face B est tournée vers le ciel. Deuxième
déduction : la face A de la pièce touche le sol, la
face B est tournée vers le ciel.
Comme nous l'écrivions dans le premier article, la pièce
d'ambre présente trois paquets d'oeufs. Bien qu'éloignées
dans la pièce d'ambre, les trois ouvrières qui portaient
ces oeufs ont été surprises et figées dans la même
posture. Autre particularité : ce sont les seules fourmis dont
la tête est parallèle à la paroi de l'ambre (notée
A), la partie inférieure de leur tête étant tournée
vers cette face. Il y a vingt-cinq millions d'années, à
la frontière des périodes Oligocène et Miocène,
la force de gravité avait bien entendu la même direction
et le même sens que de nos jours. Il ne fait par conséquent
aucun doute que la face A touche le sol tandis que la face B est celle
qui regarde vers le ciel. Nous voici donc en possession d'une donnée
irréfutable. Cette observation nous montre qu'une fourmi ne s'y
prend pas de la même façon pour porter un corps relativement
rigide et compact, comme une larve ou une pupe*,
et pour transporter un paquet d'oeufs visqueux et mous. Les responsables
du portage des oeufs doivent employer davantage de précautions
et rester plus près du sol. On peut encore tirer d'autres informations
de la position des oeufs. L'une de ces informations est d'ailleurs essentielle
pour poursuivre l'analyse de la pièce.
 Troisième
déduction : le registre fossile contient des informations sur
le comportement des habitants de l'inclusion. Troisième
déduction : le registre fossile contient des informations sur
le comportement des habitants de l'inclusion.
Dans les deux cas que nous venons de décrire, les oeufs sont restés
groupés et se trouvent à proximité de l'ouvrière
qui les transportait. Nous en déduisons deux choses : d'abord,
ces oeufs n'ont pu tomber de haut ; ils ont probablement été
lâchés des mandibules de la fourmi porteuse. Ensuite, il
n'a pas dû se produire d'entraînement très important
de résine. C'est un détail qui mérite toute notre
attention : s'il n'y a pas eu d'entraînement, c'est que la scène
correspond à l'activité déployée par la colonie
juste avant son inclusion dans l'ambre, ce qui revient à dire que
notre pièce contient des informations sur le comportement des fourmis
oligocènes et miocènes. Il serait bon de savoir à
quel point cette importante hypothèse est solide...
 Quatrième
déduction : les insectes sont orientés mais leurs antennes
ne le sont pas. Quatrième
déduction : les insectes sont orientés mais leurs antennes
ne le sont pas.
Une analyse statistique des directions des individus figés dans
l'ambre fait apparaître clairement deux directions perpendiculaires
privilégiées. On pourra remarquer que ceci ne concerne que
les individus et non leurs antennes, qui sont au contraire distribuées
dans l'espace d'une façon complètement isotrope.
Sachant que les antennes possèdent une grande mobilité dans
toutes les directions et une masse musculaire minime, pratiquement incapable
de résister à des efforts extérieurs, nous en déduisons
que les individus n'ont pas été entraînés par
un courant de résine et que la goutte qui a recouvert la scène
est tombée verticalement sur elle, la photographiant pour l'éternité.
Tout semble donc indiquer que les deux directions perpendiculaires ont
un lien - qui reste à définir - avec l'activité des
fourmis juste avant que la résine ne vienne soudainement les recouvrir.
Nous verrons plus loin que cette idée essentielle supporte toute
notre reconstruction historique de «Jorge Caridad». Tout autre
argument en sa faveur sera donc le bienvenu, et d'ailleurs en voici tout
de suite un autre.
 Cinquième
déduction : la goutte tombée verticalement sur les fourmis
ne les a pas entraînées. Cinquième
déduction : la goutte tombée verticalement sur les fourmis
ne les a pas entraînées.
Le diagramme des efforts internes mis en évidence grâce à
l'éclairage en lumière polarisée*
possède une symétrie radiale. Celle-ci peut être facilement
caractérisée par son centre O, au milieu de la pièce.
Ceci fait penser à la distribution isotrope d'une goutte tombée
du ciel et non au glissement d'une couche qui entraîne et réoriente
tout sur son passage. Il est dans ce cas justifié que l'effort
maximal (là où l'on trouve les tensions internes les plus
fortes) se place tout près du centre de la pièce. Il n'y
a donc plus de doute quant à la chute verticale des gouttes de
résine. Cette idée est, répétons-le, cohérente
avec premièrement, le fait qu'il n'y ait pas - ou quasiment pas
- eu d'entraînement et, deuxièmement, le fait que la pièce
renferme la mémoire d'événements survenus juste avant
l'impact qui a mobilisé à jamais la colonie.
Si
l'on observe attentivement le diagramme des efforts, on s'aperçoit
que le motif figé dans l'ambre est aussi compatible avec la participation
de deux gouttes tombées en O' et O" au lieu d'une seule tombée
en O. Ou - ce qui est encore plus curieux - avec celle d'une source de
gouttes qui aurait occupé deux positions différentes. A
ce stade de l'enquête, aucun élément ne permet de
trancher entre ces deux solutions (un ou deux points d'impact) et, à
première vue, le choix d'une solution plutôt qu'une autre
paraît avoir peu de répercussion sur la suite de notre raisonnement.
A une exception près : l'option «deux gouttes» pourrait
expliquer l'existence des deux directions perpendiculaires suivies par
les fourmis. Il suffit en effet de penser que les deux gouttes pourraient
provenir de la même source, par exemple de l'extrémité
d'une même branche. Deux gouttes issues d'un seul et même
point mais qui, observé à deux instants différents
depuis un repère solidaire de la scène, serait comme «dédoublé».
Quant aux deux directions perpendiculaires : que signifient-elles ?
S'agit-il de deux chemins de fourmis qui se croisent ou d'un seul et même
chemin qui a tourné ? La première solution est difficilement
acceptable : il faudrait en effet admettre que la goutte soit tombée
précisément là où les deux longs trajets se
rencontrent. Phénomène peu probable. Mais il est tout aussi
peu réaliste de supposer un tournant à 90 degrés
exactement. Aucune des deux solutions n'est donc convaincante.
 Sixième
déduction : les fourmis n'ont plus bougé après
l'inclusion. Sixième
déduction : les fourmis n'ont plus bougé après
l'inclusion.
Fixons maintenant notre attention sur les efforts internes au voisinage
des corps et des extrémités des adultes. Ces tensions sont
faibles, voire nulles, ce qui paraît indiquer que les fourmis n'ont
pas bougé après l'inclusion, comme cela arrive avec des
insectes plus grands et plus forts. Ce détail renforce encore un
peu plus l'idée de l'importance éthologique de la scène.
Qu'étaient donc en train de faire les fourmis ?
 Septième
déduction : les gouttes de résine sont tombées
à intervalles réguliers. Septième
déduction : les gouttes de résine sont tombées
à intervalles réguliers.
L'éclairage monochromatique de la pièce fait apparaître
la structure superposée des différentes couches correspondant
à l'étalement de plusieurs gouttes de résine. Toutes
ces couches sont relativement équidistantes, à l'exception
de celle qui contient la colonie de fourmis. Sa double épaisseur
pourrait avoir été causée par l'accumulation fortuite
de plusieurs gouttes tombées ensemble de la même branche.
De
façon générale, l'épaisseur e d'une couche
peut être directement reliée au volume v de la goutte qui
lui donne naissance et au temps t nécessaire à l'accumulation
de ce volume v. Etant donné l'équidistance des couches,
il est probable que les différentes gouttes constituant la pièce
ont été relâchées de l'arbre à intervalles
réguliers, un peu comme celles qui sortent d'un robinet mal fermé.
 Huitième
déduction : les fourmis sont en train d'effectuer un transport
urgent. Il s'agit d'une retraite organisée en dehors du nid. Huitième
déduction : les fourmis sont en train d'effectuer un transport
urgent. Il s'agit d'une retraite organisée en dehors du nid.
Le comptage des différents types d'individus indique que les adultes
sont tous occupés à transporter quelque chose. Sommes-nous
à l'intérieur ou à l'extérieur du nid ?
L'absence d'impuretés et de détritus dans le morceau d'ambre
et l'existence des deux directions perpendiculaires nous permettait d'affirmer
que la scène n'a pu se produire à l'intérieur du
nid.
En
effet, dans un endroit aussi clos, la saturation des phéromones*
aurait vraisemblablement empêché les fourmis de s'organiser
en une (ou deux) direction(s) privilégiée(s) par recrutement*.
Il existe, en outre, une seconde information essentielle pour établir
que la scène s'est bien produite en plein air : dans l'une des
couches postérieures (plus récentes) à celle qui
contient les fourmis, on peut voir en 7k un moustique en très bon
état de conservation. Or, les moustiques ne volent pas à
l'intérieur des fourmilières... Nous sommes donc en définitive
en présence d'un double recrutement organisé qui a lieu
à l'extérieur d'un nid. Pour quelle raison les fourmis ont-elles
abandonné leur nid ? Qu'étaient-elles en train de faire ?
Vers où se dirigeaient-elles ? La résine a-t-elle enregistré
voici vingt-cinq millions d'années une habitude, une situation
exceptionnelle ou les deux en même temps ?
 Neuvième
déduction : la scène nous présente une colonie
de fourmis sédentaires à plusieurs nids en état de
forte excitation. Neuvième
déduction : la scène nous présente une colonie
de fourmis sédentaires à plusieurs nids en état de
forte excitation.
Certaines fourmis, les sédentaires, vivent dans des fourmilières
permanentes, d'autres, les migratoires, vivent dans des fourmilières
temporaires. D'autres, enfin, ne se construisent jamais de véritable
nid : ce sont des nomades. Nous pouvons affirmer en toute certitude que
les fourmis de cette pièce ne sont pas des nomades.
Il
est effectivement établi que les fourmis nomades synchronisent
leurs déplacements avec les phases de développement de leurs
individus immatures. Elles peuvent être surprises en train de déplacer
des oeufs et des pupes, ou en train de transporter des larves, mais jamais
en train de transporter en même temps des oeufs, des larves et des
pupes.
Il
est par ailleurs hautement improbable qu'il puisse s'agir de fourmis migratoires.
Un tel transport serait chez elles tout à fait inhabituel et aucun
comportement de ce type n'a jamais été décrit chez
les fourmis actuelles de cette sous-famille. Les fourmis sédentaires
ont deux comportements possibles. Elles peuvent être monocaliques
(si elles ont un nid unique) ou polycaliques (si elles occupent plusieurs
nids à la fois). Dans le second cas, il s'agit, en général,
de mauvaises excavatrices ou de mauvaises constructrices qui ont, par
conséquent, plutôt tendance à profiter des cavités
ou des fissures déjà existantes. Les besoins de la colonie
étant souvent supérieurs à la capacité offerte
par un seul de ces abris naturels, les fourmis en occupent donc plusieurs
- en général quatre ou cinq - voisins les uns des autres.
En conséquence, le transport des fourmis immatures destiné
à les adapter aux changements de température et d'humidité
s'effectue dans l'espace extérieur commun aux différentes
sous-fourmilières.
Nos
fourmis sont donc vraisemblablement polycaliques. La croisée des
deux trajectoires, précisément au centre de la pièce
n'est alors plus si étonnante. En effet, le petit espace sur lequel
donnent, admettons, cinq entrées de fourmilières, peut contenir
cinq doubles colonnes de fourmis (dix colonnes en tout).
Un
tel trafic nous donne une probabilité raisonnable de points de
croisements entre deux colonnes. Un croisement de ce type à un
angle de 90° a très bien pu se produire sur une couche de résine
à demi sèche, juste avant qu'il ne pleuve une seconde goutte.
En a-t-il vraiment été ainsi ? Y a-t-il eu une alerte
générale dans la colonie ou bien celle-ci a-t-elle été
surprise ? L'identification dans la pièce d'ambre de manifestations
de stress nous permet d'aller plus loin dans l'interprétation scientifique
de la scène.
 Dixième
déduction : les fourmis étaient stressées au
moment de l'inclusion (ce qui est normal). Mais elles l'étaient
aussi avant de sortir du nid (ce qui est déjà moins normal). Dixième
déduction : les fourmis étaient stressées au
moment de l'inclusion (ce qui est normal). Mais elles l'étaient
aussi avant de sortir du nid (ce qui est déjà moins normal).
Les individus situés en (16 c) et (26 h) montrent un niveau de
stress important. Dans ces deux cas, les ouvrières serrent si fort
les immatures entre leurs mâchoires qu'elles les blessent. Le sol
semi-mouvant et odorant sur lequel elles se déplacent (ou bien
la résine qui est en train de les engloutir), ou même les
conditions qui suivent l'inclusion elle-même, peut expliquer cette
inquiétude. Autrement dit, les manifestations de stress, comme
l'excessif serrement de l'immature ou la position agressive caractérisée
par l'élévation du gastre de certains individus (visible
par exemple sur la fourmi en 17 j) peuvent être interprétés
comme les derniers gestes avant la mort (voire des gestes posthumes).
Par
ailleurs, il semble y avoir eu une alerte préalable qui a incité
les fourmis adultes à emporter les immatures hors du nid de façon
inhabituelle et précipitée (remarquez les différentes
façons dont les adultes attrapent les immatures). Il faut savoir
que le stress du moment de l'inclusion est fréquemment observé
chez l'insecte qui se trouve englué dans l'ambre. En revanche,
le stress «historique», c'est-à-dire relié à
un événement antérieur à l'inclusion, n'a
été observé que sur cette pièce.
 Onzième
déduction : il pleuvait de la résine partout. Onzième
déduction : il pleuvait de la résine partout.
Le moment du drame fait donc intervenir deux actions principales : une
scène routinière (les déplacements entrecroisés
des fourmis polycaliques) et une certaine alarme qui avait sans doute
déjà sonné à l'intérieur de la fourmilière
avant l'inclusion. Quel événement a pu alarmer la colonie ?
On peut facilement imaginer plusieurs phénomènes : séismes,
orages, inondations, sécrétion extraordinaire de résine,
incendie, chute de météorite, attaque de la colonie par
d'autres animaux... Un indice favorise légèrement une hypothèse
par rapport aux autres : c'est le morceau d'ambre lui-même ! Si
de la résine tombait sur un point, on peut imaginer qu'en d'autres
endroits assez proches le même phénomène se produisait.
Nous savons que les fourmis de ce genre, les Technomyrmex, font leurs
nids dans le sol des bois, parmi les feuilles, les branches, les racines
et les troncs. On peut donc imaginer sans risquer de se tromper un paysage
battu par une pluie de résine, celle-ci pouvant par endroits pénétrer
dans quelques-uns des sous-nids de la colonie polycalique.
Nous
voici presque au bout de notre recherche.
Le moment est venu de rassembler toutes
nos conclusions dans une histoire vraisemblable, la plus vraisemblable
compte tenu des onze points que nous venons de détailler.
«Jorge
Caridad»
ou la brève et triste histoire d'un instant de l'Oligocène.
Nous
sommes en présence d'une fourmilière de la forêt tropicale,
il y a vingt-cinq millions d'années. Elle est habitée par
une espèce de fourmi polycalique (de la sous-famille des Dolichoderinae
, du genre des Technomyrmex). Les cavités naturelles exploitées
par les insectes pour y installer leur colonie sont voisines les unes
des autres et, dans l'espace extérieur commun à toutes les
entrées, les ouvrières transportent, de manière routinière
et ordonnée, les membres immatures (oeufs, larves et pupes) pour
lesquels elles recherchent les meilleures conditions de température
et d'humidité (1). Dans le coin réservé
aux immatures, l'obscurité est totale.
La
perception des adultes essentiellement tactile et chimique est envahie
de données alarmantes (2). Quelque
chose de poisseux et de très odorant semble envahir leur domaine.
Les fourmis responsables des immatures sont pressées et soucieuses,
à tel point qu'elles ne se donnent plus le temps de les saisir
dans les règles de l'art (3). Au-dessus
de la fourmilière, une plante, une Hymenaea, dont les racines s'étendent
dans tout le sous-sol, commence à exsuder de la résine de
façon anormale (4). Le mot d'ordre
est lancé : il faut abandonner ce sous-nid avant qu'il ne soit
trop tard. Il y a de l'urgence dans l'air mais pas de panique. Les fourmis
chargées qui d'une larve, qui d'une pupe, qui d'un paquet d'oeufs,
atteignent la sortie (5). Là, elles
trouvent la piste des phéromones qui conduit par l'extérieur
à l'entrée d'un autre sous-nid. La trajectoire des fourmis
alarmées croise celle d'autres fourmis qui le sont moins qu'elles
(6). Il y a donc une routine ordinaire doublée
d'une alarme extraordinaire. La résine descend des troncs et des
branches d'arbres (7) et, de temps en temps,
les gouttes se détachent et viennent s'écraser sur le sol.
Par terre, elles s'accumulent en certains endroits et dans certaines cavités.
Les taches de résine à terre (8)
sont peut-être tombées pendant les heures de chaleur de la
veille, ce qui explique pourquoi leur surface a déjà acquis
une certaine rigidité. Deux trajectoires, qui forment un angle
de 90°, se croisent exactement sur l'une de ces taches à demi
sèches (8). Les fourmis sont un peu
perturbées lorsqu'elles croisent leurs congénères
mais, très vite, retrouvent la piste des phéromones. Il
en va toujours ainsi sur la «place du village».
Mais,
aujourd'hui, quelque chose de nouveau semble se produire. Le croisement
se fait sur une plaque de résine à demi-sèche et
quelques fourmis deviennent nerveuses. Leurs pattes s'enfoncent bien trop
vite dans ce sol mou et une maudite odeur envahit petit à petit
le terrain. Les ouvrières qui transportent les oeufs progressent
plus doucement ; elles doivent accomplir des miracles d'équilibre
pour avancer sans lâcher cette masse molle difficile à saisir.
Celles qui tiennent les larves et les pupes les serrent plus fort entre
leurs mandibules parce que le sol se dérobe sous leurs pattes et
que l'odeur de résine couvre celle des phéromones. Certaines
font même tomber leur précieux fardeau. Les choses en étaient
là ... lorsqu'une grosse goutte de résine fraî- che
s'est brusquement détachée d'une branche recouvrant les
deux colonnes d'insectes (9). Quelque temps
après, d'autres gouttes retombèrent au même endroit.
Et vingt-cinq millions d'années plus tard, une scène éthologique
étonnante était découverte dans une mine de la République
dominicaine...
Comment
une colonie de fourmis polycaliques s'est retrouvée piégée
dans une pluie de résine il y a vingt cinq millions d'années.

Si
ce récit s'avère le bon, nous sommes en possession d'une
observation scientifique rare : celle d'une retraite organisée,
d'un recrutement d'alerte générale chez des fourmis polycaliques.
Bien sûr, la prudence s'impose : une nouvelle technique, une nouvelle
idée, une nouvelle donnée peuvent faire basculer d'un coup
la vérité que nous avons construite. Cette pièce
d'ambre contient toute l'information sur la mésaventure de ces
fourmis : à nous, chercheurs, éthologues, entomologistes,
professionnels ou amateurs, de reconstituer le plus précisément
possible cette histoire, en évitant soigneusement les pièges.
Rares sont les morceaux d'ambre à inclusions qui ont fait l'objet
d'autant d'attentions que «Jorge Caridad». Une enquête
scientifique qui n'est pas encore achevée puisque cette pièce
restera, au musée de la Science de la fondation «La Caixa»,
à la disposition de tous ceux qui souhaiteront poursuivre son étude.
C'est
ainsi, nous en sommes convaincus, que l'expression «pièce
de musée» prend son plus beau sens et que l'idée
de musée est la mieux illustrée. Celui-ci n'a-t-il pas pour
vocation première de construire et transmettre aux spécialistes
et non-spécialistes à la fois la connaissance et la méthode
scientifiques ?
JORGE
WAGENSBERG, Museu de la Ciencia de la Fundacio «la Caixa»,
22 Barcelona (Espagne).
C. ROBERTO F. BRANDÃO Museum de Zoologia da universidad
de São Paulo SP, 04263-000, Brésil
CESARE BARONI URBANI Zoologisches Institut der Universitat Basel,
CH-4051, Suisse.
* PUPE
Phase pendant laquelle la larve de certains insectes prend la forme d'un
petit tonneau et reste immobile dans son enveloppe.
* EN LUMIÈRE POLARISÉE
le champ électromagnétique de l'onde lumineuse vibre dans
une direction qui reste constante.
* LES PHÉROMONES
sont des substances chimiques sécrétées par les insectes
et qui influencent les individus de la même espèce.
* LE RECRUTEMENT
est le suivi d'une direction marquée par les phéromones.
|














 Note : reportez-vous aux documents originaux
pour profiter des
Note : reportez-vous aux documents originaux
pour profiter des